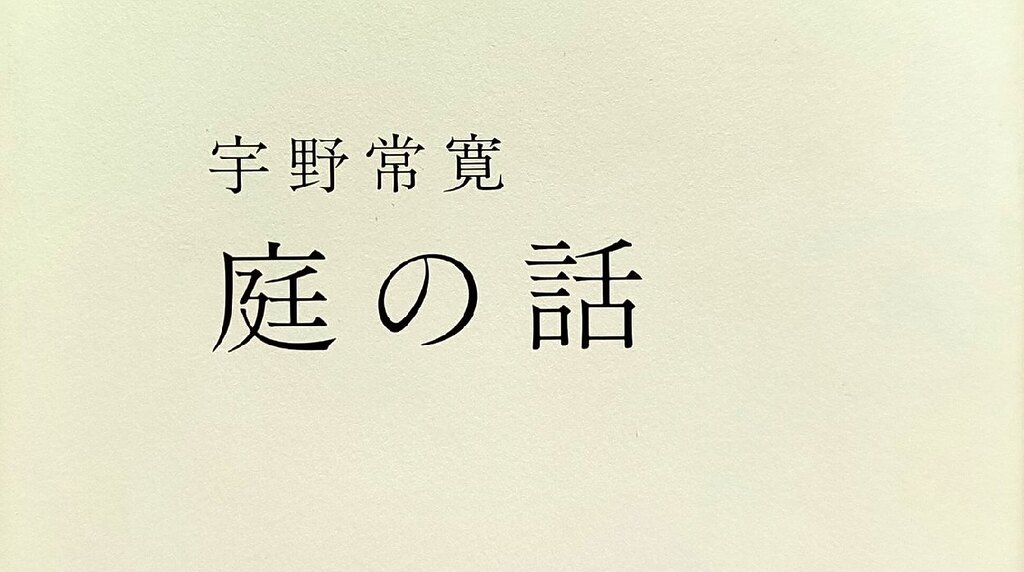« Une histoire de jardin » de Tsunehiro Uno est un livre riche en suggestions qui offre une nouvelle perspective sur divers problèmes de la société contemporaine en utilisant la métaphore unique d’un « jardin ».
Dans cet article, j’essaierai de présenter des lignes directrices spirituelles et pratiques pour la poursuite continue de la créativité en appliquant le contenu de « Une histoire de jardin » à la « production musicale avec une MAO (Musique Assistée par Ordinateur) ».
- À propos de « Une histoire de jardin » de Tsunehiro Uno
- L’espace de la MAO en tant que « Jardin » : une réinterprétation de l’environnement de production numérique
- La société des plateformes et la musique MAO : le dilemme de la recherche d’approbation et de la créativité
- Production « solitaire » et connexion à la « communauté » : le rôle et les défis des communautés de production musicale
- La signification créative et théorique de « Une histoire de jardin » pour les compositeurs de MAO et l’avenir
À propos de « Une histoire de jardin » de Tsunehiro Uno
« Une histoire de jardin » de Tsunehiro Uno est un livre qui examine en profondeur l’état de la société moderne en utilisant deux métaphores symboliques : la « Maison » et le « Jardin ».
La « Maison », que Uno considère d’un œil critique, désigne les relations et les espaces fermés où les humains tentent de tout contrôler, comme les familles, les entreprises et les communautés en ligne. Ici, la pression à la conformité est susceptible d’apparaître, et la diversité ainsi que les rencontres fortuites ont tendance à être exclues.
En revanche, le « Jardin », dont Uno prône l’importance, signifie un espace mi-clos, mi-ouvert qui accepte activement la contingence et les éléments imprévisibles dépassant l’intention humaine, permettant le dialogue avec diverses choses. À travers ce concept du « Jardin », le livre examine comment les individus devraient retrouver une véritable créativité et mener une vie riche face à la « standardisation de l’humanité » et à la « perte de diversité » entraînées par les plateformes numériques.
L’importance de ce livre a également été soulignée par des penseurs contemporains tels que Koichiro Kokubun et Kazuto Ataka. En tant que tentative d’examiner en profondeur la relation souhaitable entre les plateformes numériques et les humains, son contenu était extrêmement riche en suggestions pour quelqu’un comme moi, qui pratique la production musicale à l’aide d’une MAO.
La perspective d’Uno, qui analyse méticuleusement l’impact des plateformes numériques comme les médias sociaux sur la société, puis explore le potentiel que les individus devraient viser, axé sur l’acte de « production », a jeté un nouvel éclairage sur ma propre théorie de la création, alors que je travaille jour et nuit avec ma MAO. J’ai particulièrement acquiescé à son observation selon laquelle le jeu de l’approbation et de l’évaluation qui se déroule sur les médias sociaux entrave la définition d’objectifs divers et la créativité qui devraient exister.
Les concepts de la « Maison » et du « Jardin » saisissent très justement les conflits de la production musicale assistée par ordinateur. Une MAO fournit un environnement de type « Maison » où l’on peut parfaitement contrôler chaque aspect du son et terminer une œuvre comme prévu.
Cependant, comme le critique Uno, cette orientation excessive vers le contrôle peut également causer des conflits tels que la stagnation de nouvelles idées et la perte de motivation intrinsèque due au « jeu de l’approbation et de l’évaluation » sur les médias sociaux. Dans le chapitre suivant, j’examinerai également le « rôle positif » de cet aspect de « Maison » de la MAO dans la créativité.
Uno déclare qu’un « jardin » est un « espace mi-clos, mi-ouvert ». L’aspect « mi-clos » fait référence au domaine de la « solitude » où l’on se distancie des évaluations et des tendances externes pour faire face à son propre esprit d’investigation intérieur. D’autre part, l’aspect « mi-ouvert » fait référence au domaine où il y a de la place pour que des événements contingents qui transcendent les intentions et les pensées humaines – c’est-à-dire des « écarts » et des « bruits » imprévisibles – puissent entrer. C’est la rencontre avec la contingence qui en résulte qui brise les idées fixes et offre des opportunités d’enrichir sa vie (et sa création) – ainsi poursuit l’auteur.
L’espace de la MAO en tant que « Jardin » : une réinterprétation de l’environnement de production numérique
Ensuite, en utilisant les métaphores de la « Maison » et du « Jardin » ainsi que les mots-clés de « Une histoire de jardin », je vais réfléchir à la « production musicale avec une MAO ».
La MAO est aujourd’hui un outil indispensable dans la production musicale moderne. Elle permet la gestion et l’exécution centralisées d’un large éventail de processus – composition, arrangement, enregistrement, mixage, mastering et manipulation de plugins et d’appareils MIDI externes – le tout dans l’espace personnel d’un home studio.
Ces caractéristiques, en particulier la capacité de gérer et de contrôler chaque détail de la création dans un environnement privé comme son propre domicile, sont précisément la raison pour laquelle l’environnement de la MAO peut être compris à travers la métaphore de la « Maison ».
Considérer l’environnement de production de la MAO comme une « Maison » n’est pas affirmer la « fermeture et l’uniformité » que Uno souligne de manière critique dans le chapitre précédent. Cela fait plutôt référence à des aspects de la production tels que la « stabilité », la « gérabilité » et la « planifiabilité ». Il met l’accent sur l’aspect positif d’avoir un environnement de type « Maison » où l’ordre et le contrôle sont assurés, ce qui sert de fondation permettant d’embrasser une contingence de type « Jardin » à l’intérieur et de s’immerger dans des activités créatives.
Chaque fois que j’ouvre un fichier de projet, j’ai l’impression d’être retourné dans cette « Maison » numérique. L’acte de gérer méticuleusement tout – structure des pistes, arrangement, saisie MIDI, balance de mixage, application d’effets, automatisation – et de tenter de construire un espace sonore intentionnel rappelle le travail silencieux et concentré sur une création dans une maison familière. Le processus de conception minutieuse des zones contrôlables et de construction du squelette d’une œuvre est le processus même de la création rigoureuse.
Et je prends conscience qu’au sein de ce projet de MAO, l’élément du « Jardin » respire aussi profondément en même temps. Par exemple, cela inclut des combinaisons de sons inattendues que le compositeur n’avait pas prévues ou qu’il a introduites de manière contingente, les effets imprévisibles de l’essai d’un plugin pour la première fois, et même la fonction de randomisation d’un synthétiseur, ou simplement des erreurs de manipulation et une chaîne de coïncidences.
Il arrive souvent que ces éléments incertains et contingents donnent naissance à de nouveaux éléments sonores qui vont au-delà du plan. Le bruit de larsen qui se produit lors de la création d’une chaîne d’effets complexe, ou les harmoniques involontaires nées de la superposition de plusieurs sources sonores, s’écartent partiellement du contrôle de l’auteur et peuvent apporter une profondeur et une ampleur inattendues à une œuvre.
Uno cite la « contingence qui transcende la spéculation et la pensée humaines » et la nature comme une « source mobile de nombres aléatoires » comme caractéristiques du « jardin ». Il me semble que celles-ci résonnent avec la « rencontre et la co-création avec des sons inattendus produits par une MAO ».
En d’autres termes, il est possible de considérer la riche création numérique non pas nécessairement comme quelque chose qui naît d’un contrôle absolu, mais comme quelque chose qui émerge de la culture d’un « Jardin » qui permet la « vie » de sons contingents et la « croissance » créative au sein d’une « Maison » structurée.
Et ne pourrait-on pas dire que la compétence d’un compositeur ne réside pas simplement dans la maîtrise technique, mais dans la capacité à reconnaître les « dons » contingents nés du « Jardin » numérique et à les intégrer dans l’œuvre ? Je crois que cela peut être exprimé comme « une sorte d’esthétique du hasard » et « une co-participation et un témoignage de la création en tant que devenir ».
Pour utiliser la métaphore d’Uno, peut-être que l’acte de création consiste à être témoin du « processus par lequel une œuvre se façonne elle-même » en même temps que les sons qui naissent par hasard.
La société des plateformes et la musique MAO : le dilemme de la recherche d’approbation et de la créativité
Jusqu’à présent, j’ai examiné les deux aspects de la « Maison » et du « Jardin » que possède une MAO. Ensuite, je vais approfondir les défis auxquels la production musicale assistée par ordinateur est confrontée dans la société des plateformes contemporaine.
À l’ère moderne, les principaux lieux de diffusion de la musique produite avec une MAO sont les plateformes musicales comme YouTube, SoundCloud, Bandcamp, Spotify et les médias sociaux. Des indicateurs tels que les « j’aime », le nombre de lectures, les commentaires, les partages et le nombre d’abonnés sont visualisés comme l’« évaluation » d’une œuvre, et on ne peut nier que les compositeurs eux-mêmes ont tendance à rechercher l’« approbation » à travers ceux-ci.
Comme le souligne Uno, cet « échange d’approbation » comporte le risque de perdre de vue l’objectif initial de la création et de faire de la « conquête » des algorithmes et des tendances de la plateforme l’objectif. La tentation de surfer sur les sujets en vogue ou de s’orienter vers des styles musicaux qui obtiennent facilement l’approbation afin d’obtenir plus de « j’aime » ou de lectures n’est pas une exception pour les compositeurs travaillant avec des MAO, et cette situation a le potentiel de provoquer l’« objectivation » et l’« uniformisation » de la création.
L’analyse d’Uno sur la « défaite de la fiction » – où l’« histoire réelle de l’auteur » et l’« empathie » sont plus valorisées que le contenu de l’œuvre elle-même, et le XXIe siècle est devenu une ère obsédée par la diffusion de sa « propre histoire » – recoupe les défis de communication auxquels sont confrontés les compositeurs de MAO.
De nos jours, on considère qu’il y a une tendance non seulement à publier de la musique, mais aussi à diffuser l’« histoire de l’auteur » sur les médias sociaux – son processus de production, ses sources d’inspiration, son style de vie, ses luttes personnelles et ses succès. Par exemple, il n’est pas rare que des vlogs du processus de production ou des anecdotes personnelles derrière une chanson attirent plus d’attention que l’œuvre elle-même.
Cependant, comme le souligne Uno, si « la plupart des gens n’ont pas d’histoire propre digne d’être diffusée, mais il y a une triste habitude humaine à trouver plus agréable de parler de soi », ils pourraient progressivement en venir à répéter des diffusions superficielles qui obtiennent facilement l’approbation. Cela comporte le risque de s’écarter de l’activité créatrice originale et de consacrer une grande partie de son énergie à l’autopromotion.
Cette situation peut priver les compositeurs de l’énergie et de la concentration vitales qui devraient être consacrées à la « production » profonde qu’ils devraient poursuivre – c’est-à-dire s’engager avec le son lui-même et l’explorer. En conséquence, il existe un risque de transformation en une nouvelle forme de « jeu d’approbation », où le compositeur lui-même devient un « produit », et la musique devient simplement un arrière-plan ou un outil pour mettre en valeur ce « produit », plutôt qu’une expression créative essentielle.
Production « solitaire » et connexion à la « communauté » : le rôle et les défis des communautés de production musicale
Sur la base des défis de la société des plateformes discutés ci-dessus, je vais ensuite examiner l’importance de la « solitude » dans la composition et sa relation avec les communautés en ligne.
Uno estime que pour échapper à la domination des plateformes, une « communication avec les choses » extérieure au jeu de l’évaluation mutuelle est nécessaire, et pour cela, il prêche l’importance de « rendre les humains correctement solitaires ». En d’autres termes, à notre époque moderne de connexion constante, il faut d’abord devenir solitaire pour s’engager directement avec les choses.
La production musicale à l’aide d’une MAO se déroule souvent dans l’espace personnel d’un home studio. C’est cet environnement même qui permet de s’engager avec le son dans une situation « solitaire », détachée des évaluations et des regards des autres, et de s’immerger de manière introspective dans la composition. Par exemple, le temps passé seul avec une MAO tard dans la nuit est véritablement un sanctuaire isolé du monde extérieur et un moment précieux pour le dialogue avec son moi intérieur.
Cette « solitude » ne pourrait-elle pas être le fondement de la « société où l’on peut vivre humainement, libéré de l’échange d’approbation et de la dépendance à l’évaluation sociale » que propose Uno ? Je crois que le « Jardin » pour approfondir ses questions fondamentales et découvrir des thèmes uniques, sans être submergé par des sujets superficiels, est cultivé au sein d’une telle « solitude ».
Les compositeurs de MAO peuvent recevoir des retours sur leur travail, échanger des informations, maintenir leur motivation et collaborer via des communautés en ligne (par exemple, forums, serveurs Discord, groupes sur les réseaux sociaux, etc.). Ces communautés ont des aspects positifs, fonctionnant comme une « communauté » souple et orientée vers un but, et pas seulement les aspects négatifs de la « communauté » que Uno critique (échange d’approbation, uniformité, pression des pairs). Elles sont bénéfiques en ce qu’elles complètent les activités de production « solitaires » individuelles et offrent un lieu d’apprentissage et de stimulation.
Cependant, comme ces communautés en ligne existent également sur des plateformes, elles comportent constamment le risque de tomber dans le jeu de la recherche d’approbation. Bien que les communautés offrent un soutien et des liens précieux, elles ont une vulnérabilité inhérente à tomber facilement dans le « jeu d’approbation » et l’« évaluation mutuelle » que Uno critique. Le désir de retour peut facilement se transformer en une quête de « j’aime » et de notations au sein de la communauté, sapant potentiellement la « solitude nécessaire » requise pour la création essentielle.
Les « inconvénients » d’une communauté (pression des pairs, hypersensibilité à la critique, fixation des normes d’évaluation au sein du groupe) peuvent refaire surface même dans un environnement en ligne « souple », entravant potentiellement la capacité d’un compositeur à poursuivre des « questions fondamentales » ou à s’engager avec les « choses elles-mêmes ».
L’équilibre dans la relation entre la communauté et le compositeur de MAO est très délicat. Si la relation avec la communauté est trop forte, la solitude est érodée ; si elle est trop faible, elle mène à l’isolement. Pour un compositeur de MAO, naviguer dans cette tension entre la « solitude » nécessaire à une création profonde et essentielle et la « communauté » pour la croissance et le partage est un défi extrêmement important.
Dans ces circonstances, je crois qu’en utilisant le concept de « jardin » d’Uno, il est possible de dériver un « cadre » très important pour que les compositeurs de MAO puissent bénéficier d’un « environnement numérique partagé (communs numériques) » sans perdre leur propre créativité.
Ce « cadre » ne se limite pas à l’acte de simplement incorporer des sons contingents dans une œuvre. Ce « cadre » inclut de manière complexe une façon de penser pour assurer la « solitude » qui se protège des évaluations externes et de la surcharge d’informations, un principe d’action pour la « co-création » qui utilise des éléments contingents incontrôlables comme source de création, et une attitude spirituelle de « dialogue avec les choses » qui s’engage profondément avec le son lui-même et l’explore.
En d’autres termes, ce cadre peut servir de ligne directrice complète pour que les compositeurs de MAO à l’ère de l’IA ne perdent pas de vue l’essence de leur créativité et continuent à produire une musique véritablement riche.
Et au centre de ce cadre se trouve l’idée de « cultiver son « Jardin » intérieur ».
Le « « Jardin » intérieur » fait référence à un « sanctuaire spirituel et pratique » où le compositeur peut dialoguer directement avec l’objet de la création lui-même – le son, ou la « musique » – et l’explorer, sans être excessivement prisonnier des évaluations externes ou de la pression des pairs de la communauté.
C’est le processus d’accepter les rencontres contingentes avec des sons inattendus produits par l’outil qu’est la MAO et de les intégrer dans sa propre création. Cette rencontre contingente elle-même devient un élément concret du « Jardin ». En même temps, à la racine de cette pratique se trouve la philosophie du respect de la contingence qui transcende la spéculation humaine, ce qui n’est autre que l’intériorisation du « Jardin en tant que concept abstrait ».
Par conséquent, les compositeurs de MAO devront faire l’effort de cultiver consciemment leur « jardin » intérieur tout en profitant de la diversité de l’espace numérique plus large, et ainsi continuer à favoriser des activités créatives essentielles qui ne sont pas influencées par les tentations extérieures.
La signification créative et théorique de « Une histoire de jardin » pour les compositeurs de MAO et l’avenir
Jusqu’à présent, nous avons vu comment le concept de « jardin » dans « Une histoire de jardin » apporte des aperçus intéressants sur la pratique de la production musicale à l’aide d’une MAO, et la position des compositeurs de MAO dans la société des plateformes contemporaine. Enfin, j’aimerais résumer le contenu jusqu’à présent et dériver des lignes directrices sur la manière dont les compositeurs de MAO peuvent nourrir leur créativité à l’ère de l’IA et tracer son avenir.
« Une histoire de jardin » offre des aperçus profonds et des pistes de solutions concrètes aux défis multiformes auxquels sont confrontés les compositeurs de MAO dans la société moderne, en particulier l’« inflation du désir d’approbation » par les plateformes et l’« uniformisation de la création » qui l’accompagne. La métaphore du « jardin », qui est au cœur de ce livre, nous permet de délimiter un environnement souhaitable pour les activités créatives dans l’espace numérique et une posture créative que les compositeurs peuvent choisir.
La perspective que l’environnement de production de la MAO lui-même, tout en ayant un aspect de « Maison » que le compositeur conçoit et contrôle méticuleusement, peut aussi devenir un « Jardin » qui permet une « contingence » imprévisible et une « collaboration avec le non-humain » apporte un nouveau sens et une nouvelle valeur aux activités créatives dans l’espace numérique. Cette dualité devrait permettre d’insuffler une « vie » inattendue dans une structure planifiée et de promouvoir la « croissance » créative des compositeurs dans l’environnement numérique.
Les concepts du « jardin », tels que « la joie d’être immergé dans la production », « la garantie d’une solitude correcte », « la collaboration avec le non-humain » et « l’acceptation de la contingence », seront des lignes directrices indispensables pour nourrir la créativité essentielle dans la production musicale de l’ère numérique.
Ces concepts fonctionnent comme des métaphores pour se distancier de l’environnement d’information standardisé et des jeux d’approbation des plateformes et pour retrouver une communication directe avec les choses elles-mêmes, avec le son lui-même. Et cette approche mène à une attitude de pensée et d’expression en dehors du « jeu de l’évaluation mutuelle » et de l’« économie de l’attention » sur les médias sociaux.
Ce concept de « jardin », à une époque où l’évolution technologique s’accélère et où l’IA pénètre profondément dans le domaine de la création, nous fait prendre conscience à nouveau de l’importance de la créativité spécifiquement humaine, à savoir l’attitude de poursuivre les « rencontres avec l’inattendu » et la « coexistence avec l’incontrôlable ». En d’autres termes, une créativité véritablement riche est nourrie non seulement dans la « Maison », mais dans le « Jardin » plein de contingence et de diversité.
Les compositeurs de MAO devraient voir leurs horizons s’élargir en considérant leur environnement de production non seulement comme un outil d’efficacité, mais comme un « jardin » pour pratiquer le « jardinage Tashizen ». Cela signifie une attitude d’accepter divers éléments numériques (plugins, échantillons, algorithmes) comme une « source mobile de nombres aléatoires » et de cultiver l’écosystème sonore qu’ils tissent. Il est important de reconnaître à nouveau la valeur de ne pas être trop prisonnier de la poursuite de la diffusion et de l’évaluation sur les plateformes, mais de s’engager sincèrement avec le son et de « s’immerger dans la production » dans l’espace « solitaire » d’un home studio.
Et ce qui sera exigé des compositeurs de MAO à l’avenir, n’est-ce pas de continuer à créer en « jardinant » un « jardin » unique, en incorporant activement les nouvelles technologies comme l’IA comme une « source mobile de nombres aléatoires » qui stimule la créativité, tout en tissant dans la musique les « écarts », les « bruits » et les « récits » propres aux humains que l’IA ne peut pas produire ?
Et « Une histoire de jardin » semble nous dire que la véritable créativité existe en dehors de l’approbation des autres, et qu’elle est nourrie en continuant à cultiver son propre « jardin ».