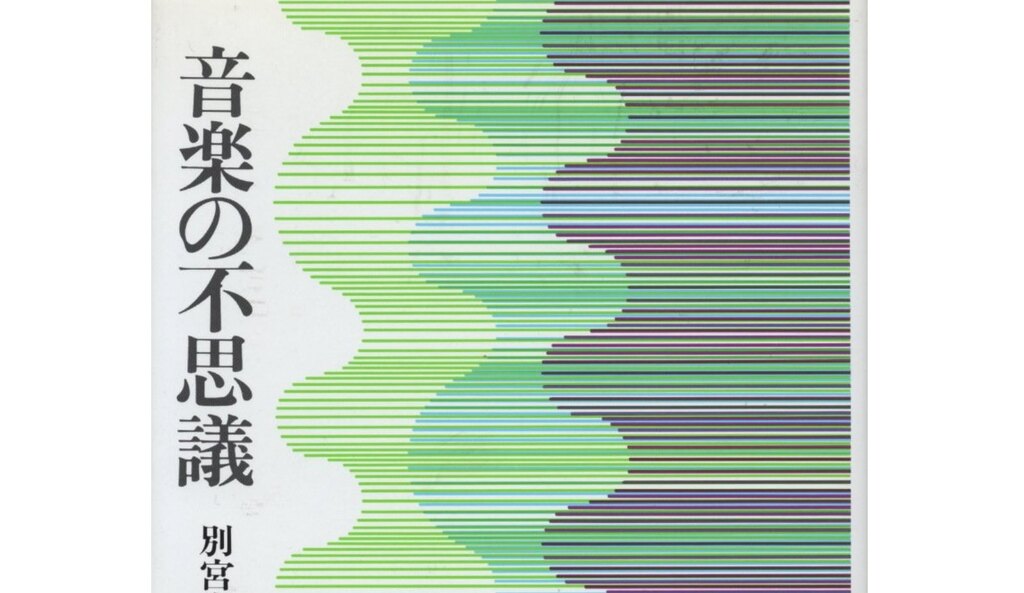(Première publication le 8 avril 2002)
Il semble que la musique ait souvent été discutée en étroite comparaison avec l’architecture depuis l’Antiquité, et la phrase du titre, « L’architecture est une musique figée », est présentée dans ce livre comme un exemple. Je trouve cette expression poétique tout à fait merveilleuse ; comment résonne-t-elle en vous ?
Cette phrase perspicace est connue pour avoir été fréquemment citée par Iannis Xenakis, un compositeur grec qui était également architecte. À proprement parler, avant Xenakis, le philosophe romantique allemand Schelling et le géant de la littérature Goethe ont utilisé des expressions similaires. Cependant, cette phrase, reliant les deux formes d’art apparemment disparates de l’architecture et de la musique, a stimulé l’imagination de nombreux créateurs.
Alors, en quoi l’architecture et la musique sont-elles similaires ? Je crois que cela devient clair lorsque nous considérons la « gravité » comme un mot-clé. Explorons cela avec l’auteur.
Tout d’abord, considérons l’architecture. Cela peut paraître abrupt, mais que se passerait-il si vous retourniez des tours en pierre, des cathédrales gothiques ou des sanctuaires et temples japonais ? Au moment où vous essaieriez de les déplacer dans cet état, ils s’effondreraient probablement, rendant impossible le maintien de leur forme. En d’autres termes, l’architecture est fondamentalement liée au concept d’une relation haut-bas.
Quelle est cette « relation haut-bas » ? Elle se réfère à « la direction dans laquelle la gravité agit ».
L’art architectural est une expression de la lutte de l’humanité contre la gravité, et à la racine de l’ordre architectural se trouve l’ordre de la gravité, l’ordre des lois mécaniques déterminant comment y faire face. (p172)
Dans l’architecture gothique, d’énormes structures sont créées en utilisant la sagesse de la forme en arc pour contrecarrer la force intrinsèquement irrésistible de la « gravité ». L’auteur suggère que ceux qui contemplent ces structures ne sont pas seulement submergés par leur taille immense, mais sont également émus en revivant cette lutte contre la gravité. L’essence de l’existence de l’architecture et de sa beauté réside dans la manière dont les couches inférieures soutiennent les couches supérieures, et comment celles-ci, à leur tour, sont soutenues par les couches inférieures.
Appliquant cela à la musique, l’auteur déclare ce qui suit :
Un son en suit un autre. Les sons s’écoulent les uns après les autres, culminant en un certain son. Pour que ce soit de la musique, le son ultérieur doit recevoir le son qui l’a précédé, tout comme la couche inférieure en architecture reçoit la couche supérieure. Ou, s’il ne le reçoit pas adéquatement, une sorte d’élan sonore est généré, et un son assez puissant pour tout rassembler et recevoir fermement vient plus tard, comme une poutre reprenant de nombreux piliers. C’est ainsi que la musique est construite. (p173)
En d’autres termes, ce qui correspond à la gravité en architecture est le temps en musique. Si vous écoutez un morceau de musique à l’envers depuis la fin, sa forme originale ne sera pas apparente. Ce que vous entendriez serait comme un tas de décombres d’un bâtiment renversé.
En architecture, de grandes structures peuvent être créées grâce à l’ingéniosité de dispositifs tels que les structures en arc pour la pierre, et les charpentes en bois, les assemblages et les poutres pour le bois. Qu’en est-il de la musique ? De même, de grandes structures peuvent être créées grâce à l’invention de « mécanismes » capables de soutenir fermement le flux du son aux points cruciaux.
Quel est ce « mécanisme » ? C’est quelque chose que quiconque ayant ne serait-ce qu’une vague connaissance de la théorie musicale a entendu : le « mouvement de dominante ». Il est aussi parfois appelé « résolution de l’accord de dominante ». Dans l’histoire de la musique occidentale, l’invention de cet « assemblage de charpente robuste » a été un événement marquant qui a permis la construction de grandes architectures musicales.
En effet, l’expansion de l’échelle dans la musique occidentale est largement due à l’influence du mouvement de dominante. Par exemple, le mouvement de dominante est indispensable pour soutenir la structure des symphonies de Beethoven. Le mécanisme derrière le sentiment que la musique progresse puissamment à travers le temps se trouve ici. Bien sûr, de nos jours, il existe aussi beaucoup de musique qui ne repose pas uniquement sur ce « mécanisme ».
Il existe une tendance à détester le fort sentiment de « progression/sensation temporelle » du mouvement de dominante, le considérant comme peu sophistiqué ou ennuyeux. D’un point de vue historique progressiste, certaines voix le qualifient de « démodé et mauvais ». Alors, quelles alternatives existe-t-il à ce « mécanisme » ?
L’une d’elles est un « changement dans la valeur de la structure », s’éloignant de « l’avancée dans le temps (accumulation) » vers un « changement continu ». Il existe des structures où la valeur suprême réside dans la manière dont le son de cet instant diffère de ce qui l’a précédé et comment il va encore changer.
Plus précisément, on peut citer la musique appelée « Onkyo-ha » (école axée sur le son), et certains sous-genres de la musique techno entreraient également dans cette catégorie. Interprétée au sens large, cette tendance peut également être observée dans certaines musiques pop. La musique minimaliste y trouverait également sa place, bien qu’il soit plus intéressant de la considérer du point de vue de « la spatialisation du temps musical par la répétition ».
Maintenant, sur la base de ces idées, il serait intéressant de laisser vagabonder notre imagination : « Si nous ignorons l’existence de la gravité en musique, c’est-à-dire si nous devions créer une structure musicale en apesanteur, quel genre de musique serait possible ? »
L’auteur affirme que cela a déjà été fait dans la musique dodécaphonique. En effet, en écoutant une telle musique, on ressent rarement un mouvement de dominante traditionnel. Et le sentiment d’indicible flottement éprouvé en l’écoutant pourrait s’apparenter à l’anxiété d’être projeté dans un espace en apesanteur.
Cependant, envisager des mécanismes structurels qui peuvent être efficaces précisément dans ce sentiment d’apesanteur pourrait être un point important pour enrichir la palette des techniques de composition.
Titre (japonais) :『音楽の不思議』
Auteur :別宮 貞雄 (著)
ISBN : 4276200806
Articles connexes