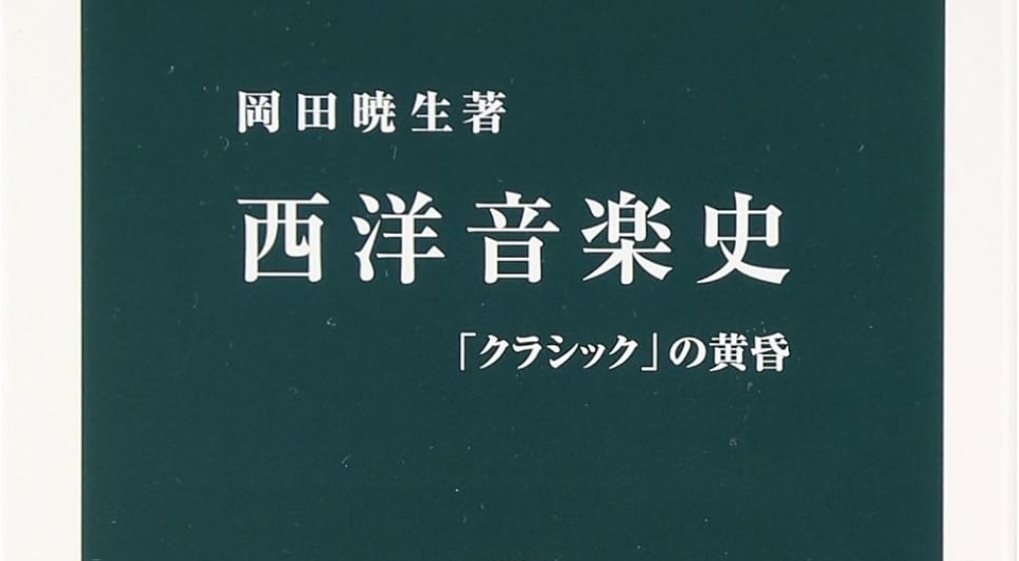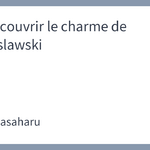(Première publication le 28 novembre 2008)
C’est un ouvrage merveilleusement ambitieux. Parmi les livres d’histoire de la musique qui tendent à rechercher la précision et l’exactitude académiques, ou qui se contentent souvent d’expliquer les figures historiques, ce livre se distingue. Il aborde la « musique occidentale (savante) » comme une « musique consignée sur partition » et, à travers ce prisme, raconte avec audace le cours de l’histoire de la musique en la contextualisant fermement dans les conditions sociales, les structures et les hiérarchies socioculturelles de chaque époque.
En tenant compte de ces situations sociétales et de ces caractéristiques régionales, des aspects tels que la relation avec la pensée des Lumières à l’époque de Beethoven, ou la nature de la musique (notée) sous les monarchies absolues, émergent de manière très tridimensionnelle. Bien que ce soient des sujets fréquemment abordés dans les précédents livres d’histoire de la musique, la force de cet auteur en tant que narrateur singulier transmet de manière dynamique les changements et les continuités des époques.
Comme l’auteur l’affirme au début, « Je n’ai pas peur de parler à la première personne, « je » », une caractéristique essentielle de ce livre est la clarté du point de vue de l’auteur. Ceci est détaillé dans la préface et le chapitre 1, et ses résultats peuvent être observés, par exemple, dans le chapitre 5, « Grandeur et contradictions de la musique romantique ». Les compositeurs de cette période étaient, pour ainsi dire, « un agglomérat d’individualités intenses », et la plupart des histoires de la musique tendent à devenir une « série de biographies de compositeurs », estompant souvent la vue d’ensemble du contexte historique, des trajectoires sociales de leurs activités, ainsi que de leurs interrelations et continuités.
Cependant, l’auteur cite ici l’établissement des concerts et de la critique musicale au XIXe siècle, le système des conservatoires de musique qui s’est implanté à cette époque, et les changements importants au sein du public. En entrelaçant ces mouvements sociétaux avec la dimension régionale, il dépeint les musiciens tels qu’ils ont été ballottés, auxquels ils se sont adaptés ou qu’ils ont surmontés, les mettant en lumière comme faisant partie d’un flux plus large de l’histoire de la musique.
Avec Paris comme centre symbolique, des genres tels que l’opéra, la musique virtuose et la musique de salon ont prospéré, menant à une forme de « popularisation ». Simultanément, dans les régions germanophones, la « musique sérieuse » a émergé sur fond d’une valorisation du raffinement culturel (Bildung), donnant naissance à une tendance à rechercher la « profondeur et l’intériorité » dans la musique. Ce cinquième chapitre est particulièrement captivant, y compris l’observation selon laquelle les racines du conflit « musique de divertissement contre musique savante » se trouvent à cette époque.
Un inconvénient, cependant, est que le traitement de la musique populaire du XXe siècle dans la dernière partie du livre donne indéniablement une forte impression d’être partial. Mais cela pourrait aussi être une approche délibérée découlant de la position de l’auteur, et il est un fait que cette approche rend les affirmations finales assez mémorables.
C’est un excellent livre qui vous permet de faire l’expérience du flux historique d’où venait la musique occidentale (savante) et où elle est allée, et d’où la musique actuelle a jailli, véritablement comme un « grand fleuve ». Comme le dit l’auteur, il ouvre les yeux sur « la joie d’écouter la musique historiquement ».
Informations complémentaires sur le livre
Titre (japonais) :『西洋音楽史 「クラシック」の黄昏』
Auteur :Akeo Okada (Auteur)
ISBN : 4121018168
Table des matières de « Histoire de la musique occidentale – Le crépuscule du « classicisme » »
- Préface
- Chapitre 1 : La musique médiévale énigmatique
- Qu’est-ce que la musique savante ? / Au commencement était le chant grégorien / Sur la formation du monde occidental / ‘Musica enchiriadis’ – L’histoire commence à avancer / Le développement de l’art de l’organum / L’École de Notre-Dame et le siècle gothique / L’ordre résonnant des nombres / L’Ars Nova et le crépuscule du Moyen Âge
- Chapitre 2 : La Renaissance et le « commencement » de la musique
- La musique devient « Beauté » / L’école franco-flamande au XVe siècle / À propos du cantus firmus / La naissance du « compositeur » / L’espace en expansion de l’histoire de la musique et le XVIe siècle / De l’école franco-flamande à l’Italie / La découverte du « son » et de la « dissonance » – Vers le Baroque
- Chapitre 3 : Baroque – Déjà-vu et malaise
- L’intelligibilité et l’inintelligibilité de la musique baroque / La musique à l’époque de la monarchie absolue / La naissance de l’opéra – La musique devient drame / La monodie et la basse continue / Le principe du concerto / La culture musicale de l’Allemagne protestante – Le problème Bach / Mon opinion personnelle sur la « grandeur » de Bach
- Chapitre 4 : Classicisme viennois et l’utopie des Lumières
- La musique pour les citoyens modernes commence ici / La voie vers le classicisme viennois / Les techniques de composition de la musique classique / L’établissement de l’espace public en musique / La musique symphonique et la naissance d’une nouvelle communauté / La forme sonate et l’esprit de la rhétorique / Mozart et l’opera buffa / Beethoven et l’avenir de la « musique des Lumières »
- Chapitre 5 : Grandeur et contradictions de la musique romantique
- La musique du XIXe siècle – Une floraison d’« individualité » / Critique, écoles de musique, chefs-d’œuvre / Bluff et opérations de masse / Grand opéra et musique de salon – La vie musicale à Paris / La prière d’une vierge / La vénération de la musique instrumentale et la culture de l’écoute attentive – Le cas de l’Allemagne / Romances sans paroles, musique à programme, musique absolue / La naissance de l’« émotion » en musique
- Chapitre 6 : Maturité et effondrement – Du tournant du siècle à la Première Guerre mondiale
- Le dernier éclat de l’histoire de la musique occidentale ? – L’ère post-wagnérienne / La renaissance de la musique française / Nouvelles opportunités pour l’exotisme / Richard Strauss et l’orchestre mammouth / La musique religieuse à une époque sans Dieu – Les symphonies de Mahler / Transgression ou catastrophe ? – La veille de la Première Guerre mondiale
- Chapitre 7 : Que s’est-il passé au XXe siècle ?
- La fin de la Première Guerre mondiale et la rupture avec le romantisme / Le déni du mythe de l’originalité – Stravinsky à l’époque néoclassique / Un prophète criant dans le désert – La technique dodécaphonique de Schönberg / La tâche difficile de reconstruire la « forme » / Une « histoire de la musique contemporaine » est-elle possible ? – Un aperçu de l’après-Seconde Guerre mondiale / Musique d’avant-garde, interprétations de virtuoses, musique populaire / L’Évangile et la malédiction du romantisme
- Postface
- Guide bibliographique
À propos de l’auteur
Akeo Okada
Né à Kyoto en 1960. Il a quitté le programme de doctorat de l’École supérieure de l’Université d’Osaka après avoir validé les crédits requis. Après avoir été assistant à la Faculté des Lettres de l’Université d’Osaka et professeur associé à la Faculté de Développement Humain de l’Université de Kobe, il est devenu professeur associé à l’Institut de Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Kyoto. Docteur ès Lettres. Ses publications comprennent « Le Destin de l’opéra » (Chuko Shinsho, Prix Suntory des Sciences Sociales et Humaines).(Cité de ce livre)