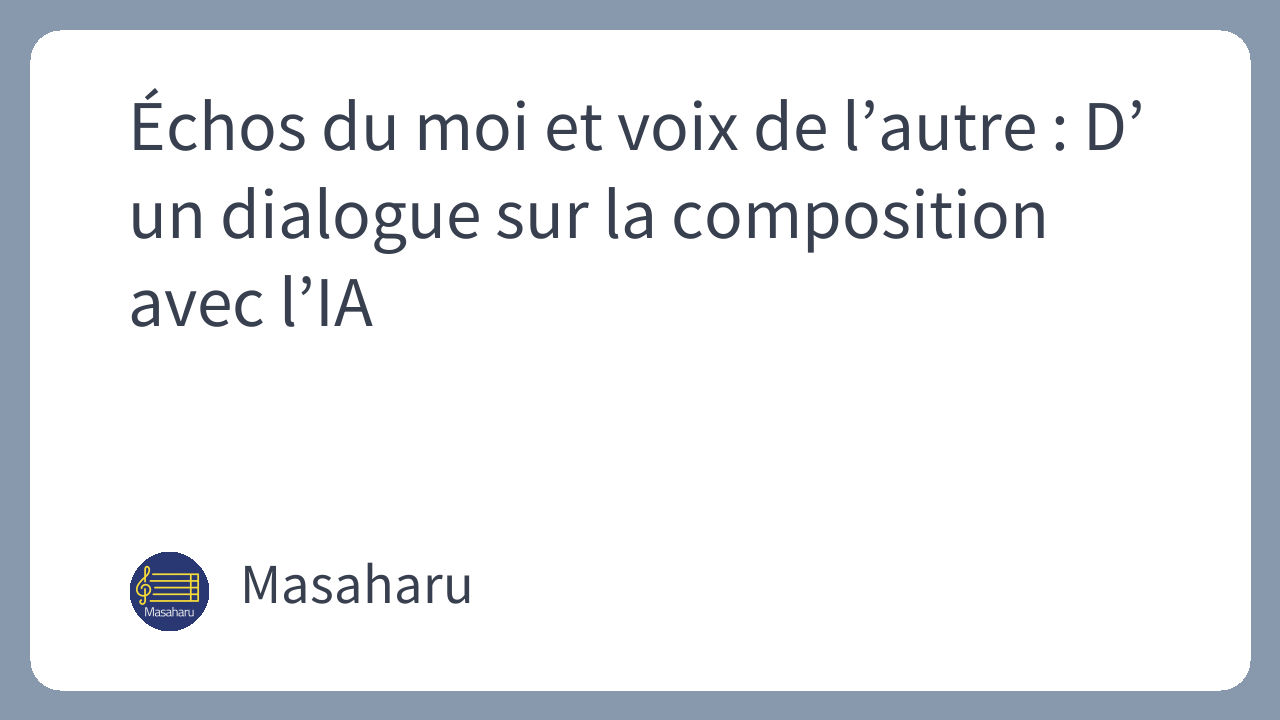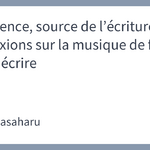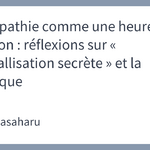Alors que la composition par IA se répand rapidement, nous, compositeurs, nous demandons quotidiennement comment nous devrions aborder ce nouvel outil. Cette fois, j’aimerais faire avancer mes considérations en démêlant le processus de pensée que la composition par IA a apporté à « moi en tant que compositeur ».
Dans cette réflexion, j’ai progressé en prenant une IA (Gemini) comme partenaire de discussion. C’est devenu un échange dans un environnement qui donnait une sensation étrange du point de vue humain – discuter de la composition par IA avec une IA.
La composition par IA est-elle de la « composition » ? Un dialogue entre le matériau et la sensibilité
Lorsque j’ai utilisé pour la première fois un outil de composition par IA comme Suno, j’ai eu le sentiment que « cela s’apparente plus à l’acte de « digger » de la musique (explorer/rechercher) qu’à celui de composer ».
C’était moins le sentiment de tisser les notes une par une de mes propres mains, et plus celui de chercher quelque chose qui captive mon cœur parmi les innombrables œuvres présentées par l’IA. Il semblait y avoir la joie de la découverte, comme de trouver un disque préféré parmi les vastes œuvres du marché de la musique – une sorte de « crate-digging ».
Cette expérience m’a incité à réinterroger la définition de l’acte de « composition » en moi-même. En premier lieu, la composition se réfère-t-elle uniquement à la création de tout à partir de zéro ?
En réfléchissant à la réponse à cette question, j’ai réaffirmé le fait que j’accorde personnellement de l’importance à la « construction » en tant qu’aspect majeur de l’acte compositionnel – en d’autres termes, que je « compose en engageant un dialogue musical avec des matériaux ».
Cela signifie que je perçois les « œuvres finies » générées par l’IA, ainsi que les phrases fragmentaires, les rythmes et les progressions harmoniques/d’accords, comme des « matériaux » uniformes, et mon acte de composition naturel consiste à réfléchir à la manière de les agencer et au contexte à leur donner.
Par exemple, on pourrait superposer des harmonies et des mélodies qui évoquent un sentiment de polymodalité sur une partie spécifique d’un morceau généré par l’IA, construisant ainsi un nouvel espace harmonique. Cela aurait probablement pour résultat de défamiliariser le contexte musical (le message ou le récit qui vise un genre ou une époque spécifique) que possédait l’« œuvre finie par l’IA » originale.
Un tel processus peut être décrit comme un dialogue entre le matériau et la sensibilité. À travers ce dialogue, de nouvelles significations et de nouveaux récits musicaux naissent.
En ce sens, l’IA n’est pas simplement une « technologie », mais pourrait peut-être être qualifiée de nouveau « partenaire de dialogue » dans mes propres activités créatives.
Lorsque je considère cette image de « l’IA comme partenaire de dialogue pour ma sensibilité », je me rends compte que ce n’est rien de spécial, mais quelque chose que l’on a déjà vu dans l’histoire de la musique.
Autrefois, il y avait le jeu de dés musical de Mozart ; au XXe siècle, les opérations aléatoires de John Cage (musique aléatoire) et la culture de l’échantillonnage du hip-hop – tous sont des rencontres avec des « éléments imprévisibles » venus de l’extérieur. L’IA compositionnelle est sa variante moderne, une entité qui reconstruit statistiquement la contingence.
Dans le cadre d’un « dialogue de sensibilité » avec le « matériau en tant qu’autre » venant de l’extérieur du compositeur, l’émergence de la composition par IA elle-même n’est pas une anomalie ou une singularité particulière dans l’histoire de la musique, mais l’aspect d’elle n’étant qu’une variation contemporaine de cette tendance devient visible.
Où trouver l’existence de la musique
Maintenant, l’existence de l’IA en tant que partenaire de dialogue musical dans la composition est liée à ma propre vision de la musique – c’est-à-dire ma position de chercher l’existence de la musique dans des « conditions subjectives » plutôt que des « conditions objectives ». En d’autres termes, je prends la position que « la musique existe au sein de la sensibilité de l’auditeur ».
Le matériau musical présenté par une IA compositionnelle n’est peut-être rien de plus que le résultat du traitement statistique de vastes quantités de données. Cependant, lorsque je trouve une beauté subjective dans ce matériau, la signification de celui-ci en tant que « musique » y émerge.
À ce stade, l’IA avec qui je discutais a soulevé la question de savoir quelles qualités sont requises d’une IA compositionnelle pour établir un « dialogue ».
Par exemple, devrais-je attendre une IA qui non seulement génère divers matériaux de manière aléatoire, mais qui apprend aussi mes goûts musicaux et fournit des réponses qui rendent le « dialogue » plus vivant ? Ou bien une entité étrangère qui fonctionne selon une logique complètement différente est-elle plus souhaitable pour obtenir des créations contingentes et fraîches ?
Je crois que les deux ont un grand potentiel. Ce qui est important, après tout, n’est pas ce que l’IA produit, mais ce que je trouve dans ce matériau.
De plus, l’IA demande :
- Et si une IA compositionnelle apprenait statistiquement la beauté subjective que l’auteur a trouvée et commençait à générer du « matériau musical que l’auteur trouverait probablement beau » à un niveau plus prévisible ?
- N’est-ce plus un dialogue, mais plutôt le fait d’être piégé dans un espace où sa propre voix ne fait que résonner en écho sur un mur ?
- À ce moment-là, ne ressentirait-on pas un sentiment de vide, en réalisant qu’on n’écoute qu’un « écho de soi » – c’est-à-dire une « musique autistique et autonome » ?
À cette question, j’ai transmis ma pensée selon laquelle le fait de trouver de la valeur dans un « écho de soi » peut également être traité comme un jugement subjectif dans un sens méta.
C’est l’idée qu’atteindre une création qui est une « forme de perfection autistique » en tant que forme de création, tout en ressentant une certaine beauté sublime dans l’existence d’un « écho de soi » d’une telle pureté, est également une perspective attrayante.
Pour qu’un tel « écho de soi » soit créatif, il serait important qu’il s’agisse d’une fermeture (occlusion) consciemment choisie. Alors que la répétition due à l’inertie inconsciente peut conduire à la stagnation ou à la régression, une fermeture intentionnelle a le potentiel de devenir une purification de la forme.
Le corpus d’œuvres en tant que corps en mouvement
En réponse à mes pensées, l’IA a posé la question : « Comment distinguez-vous une forme de perfection autistique d’une stagnation ou d’une régression créative ? »
En réponse, je suis retourné à la prémisse même de la question et j’ai pensé : « Cette distinction est-elle nécessaire en premier lieu ? »
Et j’ai choisi d’aborder cette question non pas du point de vue du jugement de la qualité des œuvres individuelles, mais de la perspective de les considérer toutes comme un seul flux pratique de l’« histoire de l’auteur » – c’est-à-dire comme un « corpus d’œuvres en tant que corps en mouvement ».
En prenant une vue d’ensemble de la trajectoire dessinée par les œuvres musicales nées du dialogue avec l’IA compositionnelle, je devrais être capable d’observer où se dirige mon moi intérieur – le « degré de pureté (autisme) ».
La visualisation de ce « corpus en mouvement » sera une méta-auto-évaluation indispensable pour observer objectivement sa propre croissance et ses changements et pour déterminer la direction de la prochaine création.
Impressions
À travers la discussion et la réflexion avec l’IA comme décrit ci-dessus, j’ai le sentiment d’avoir progressé dans la verbalisation d’un aspect de mon approche de l’IA compositionnelle.
Mon impression initiale cette fois est que la composition par IA a le potentiel d’être non seulement un outil pratique, mais aussi un « nouveau miroir » pour réexaminer sa propre philosophie créative et explorer son moi intérieur.
Et je crois que ce « miroir », en un sens, est quelque chose de trop évident pour l’auteur, mais qui n’a pas été clairement verbalisé jusqu’à présent, et il vous force à faire face à de tels « angles morts ».
Enfin, en guise de remarque complémentaire, il existe divers problèmes existants autour de l’IA générative que je n’ai pas abordés ici (tels que l’origine et le droit d’auteur des données à partir desquelles l’IA générative apprend, et les arguments contre l’IA générative), mais j’ai estimé que ceux-ci dépassaient mes capacités actuelles, c’est pourquoi j’ai décidé de définir le thème et de mener la discussion dans cet article.