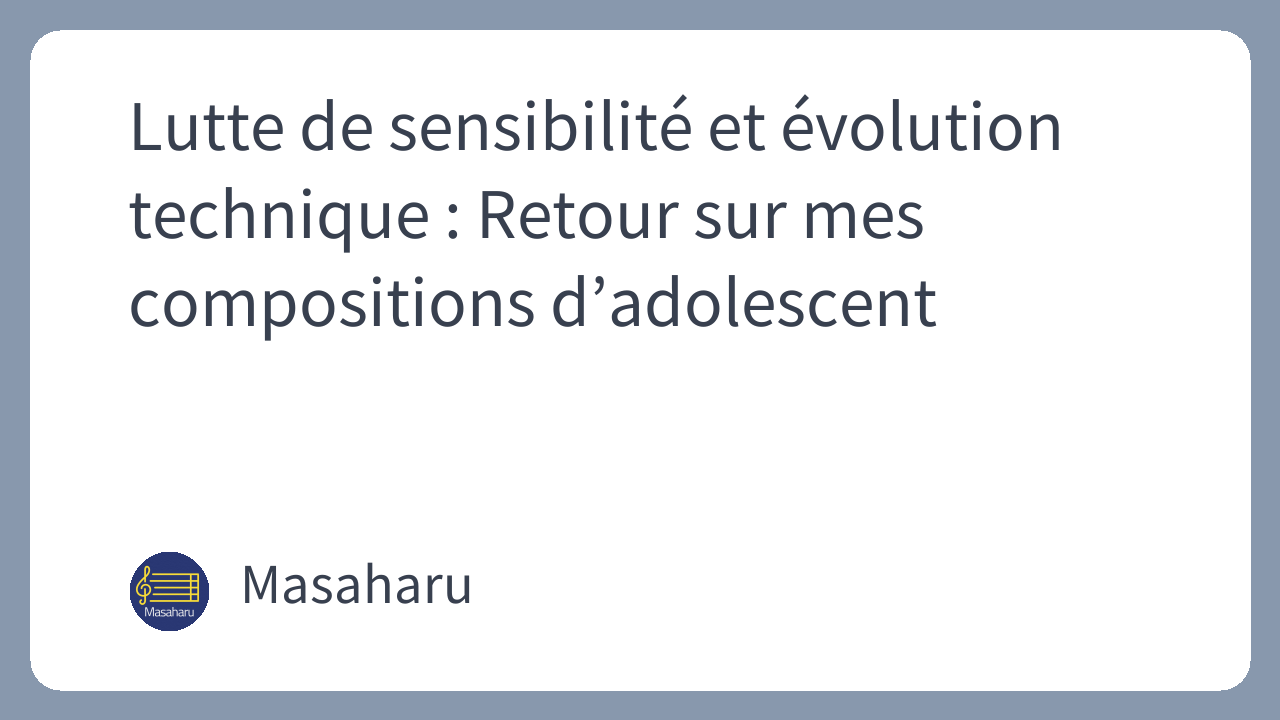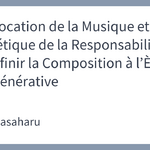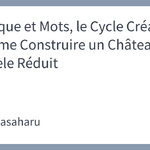Dans cet article, je vous propose de revenir sur le style de composition et l’approche créative de mon adolescence, en réécoutant les œuvres que j’ai composées à cette époque.
Ce sera sans doute un contenu personnel et nostalgique, mais j’y décrirai quel genre de musique une personne qui débutait tout juste la composition pouvait créer, dans quel contexte et avec quelles émotions. J’espère que vous apprécierez ce voyage dans le temps.
À propos de ma toute première chanson (composée en 1987)
J’ai terminé ma première œuvre musicale originale à l’hiver 1987, à l’âge de 14 ans, alors que j’étais en deuxième année de collège. Je l’ai composée sur un ordinateur NEC PC-8801FH, en utilisant un langage de programmation musicale appelé MML (Music Macro Language).
Malheureusement, l’enregistrement audio n’existe plus, mais c’était un morceau joué entièrement avec un « son de type cloche en synthèse FM avec un long déclin », qui résonnait comme un adagio pour ensemble à cordes.
Le morceau décrivait un processus allant du silence au sommet de la résonance, avant de retourner au silence. Dans un flux lent, comme le son d’une cloche que l’on frappe, le volume augmentait progressivement, et le morceau avançait petit à petit en répétant des cadences simples et des modulations suggérant une ascension – un morceau de quelques minutes.
Je me souviens avoir été sensible à l’harmonie musicale (la sonorité des accords et des modulations) depuis mon enfance, et je constate que cette « préférence » s’était naturellement tissée dans ma toute première chanson.
Par la suite, j’ai continué à utiliser le PC-8801FH et le X68000, manipulant les sources sonores FM (et PCM) avec MML pour créer des morceaux originaux et des reprises de musiques de jeux vidéo.
Puis, à 16 ans, j’ai enfin acquis les instruments MIDI dont je rêvais et j’ai mis le pied dans le monde de la production musicale sérieuse (musique séquencée).
Les œuvres que je possède encore aujourd’hui datent de 1989 et au-delà, après que j’ai commencé à produire de la musique avec des instruments MIDI à l’âge de 16 ans.
Je vais donc maintenant sélectionner cinq morceaux caractéristiques parmi ceux que j’ai composés entre 16 et 19 ans, et y revenir en écoutant les enregistrements de l’époque.
Notez que les sources audio incluses ici ont subi un léger traitement de mastering (égalisation, compression, etc.).
« Icy Hands » (composée en 1989)
C’est une œuvre de mes 16 ans (deuxième année de lycée), produite avec le KORG M3R, qui venait de sortir à l’époque. Le séquenceur (ce qu’on appelle aujourd’hui une DAW) était l’environnement MML du X68000, sur lequel était installé un pilote d’extension MIDI.
C’est l’un de ces morceaux où, inspiré par les musiques de jeux vidéo et la musique fusion que j’aimais à l’époque, j’essayais de donner forme à mes propres « goûts » tout en les imitant.
Le rythme est emprunté au metal rock, et l’harmonie, basée sur le mode mineur, est péniblement tissée, bien que maladroitement, en imaginant une « musique de jeu vidéo majestueuse et héroïque ».
La structure, qui module à chaque section, et l’approche visant à absorber l’écart de ces modulations par la ligne mélodique, me semblent toutes deux intéressantes, même aujourd’hui. Elles révèlent à la fois « l’attitude exploratoire » et la « franchise à suivre mes propres sensations » de l’époque.
À cette période, je commençais à peine à apprendre la théorie des accords, donc je n’étais pas encore capable de l’appliquer à la composition ou de l’utiliser pour l’analyse. Mais en contrepartie, je pouvais me concentrer sur la composition en me confrontant sérieusement à mes propres sensations.
Plus tard, à mesure que je maîtrisais la théorie musicale et diverses techniques, ce conflit initial, que l’on pourrait qualifier de « lutte avec la sensibilité », a temporairement disparu de mon son.
Ce morceau n’est ni stylé ni raffiné ; il dégage une sensation brute, non polie. Mais c’est un morceau mémorable qui me rend pensif, car je sais que c’est une œuvre que je n’aurais pu créer qu’à cet âge. (J’aimais beaucoup le refrain de ce morceau, au point de le réutiliser des années plus tard dans « Behind ».)
Le mixage est dans un état typique de « réverbération de salle de bain », ce qui me fait sourire ironiquement de mon propre amateurisme. Je me souviens que j’étais tellement content de la richesse sonore que la réverbération apportait que j’avais tendance à en abuser.
Ce morceau n’est pas le pire, mais une caractéristique de cette période est la présence de titres étranges. Par exemple, un morceau de la même époque intitulé « Kink Nail » se traduit littéralement par « Ongle tordu ».
Cela s’explique par une gêne à donner des titres trop fidèles à l’image que j’avais en tête, ce qui me poussait à choisir délibérément des mots peu compréhensibles. Repenser à mon état d’esprit de l’époque me fait sourire.
Aussi, la « caisse claire KORG », que j’ai continué à utiliser pendant un certain temps, éveille une forte nostalgie. C’était une caisse claire si caractéristique et mémorable que quiconque connaissant les instruments MIDI de cette époque la reconnaîtrait immédiatement comme « Ah, ce son KORG ». (Le son du piano KORG était également très distinctif.)
D’ailleurs, cette caisse claire était également utilisée pour la batterie PCM dans la version X68000 du jeu « Bosconian », elle devait donc être familière aux utilisateurs du X68000.
« Final Takeout » (composée en 1990)
Ce morceau date de mes 17 ans (dernière année de lycée), créé quelques mois après « Icy Hands », également avec le KORG M3R.
La « timidité face aux titres » que j’évoquais pour le morceau précédent se retrouve ici. Le titre est un jeu de mots sur le nom de la musique du jeu Sega « Final Take Off », mais c’est un titre qui reflète l’erreur de jeunesse, me faisant penser : « Sérieusement, ‘Le dernier plat à emporter’ ? »
Dans ce morceau, les harmonies sont soudainement devenues beaucoup plus claires. Cela montre que, pour le meilleur ou pour le pire, je m’habituais à la théorie des accords grâce à mon apprentissage.
La structure du morceau est également basée sur la musique populaire, suivant les constructions courantes de la musique instrumentale fusion, et se termine par un fondu sortant (fade-out) sur la répétition du refrain.
D’une introduction en mode majeur lumineux, on glisse doucement vers un couplet (section A) en mineur plus sombre. Juste au moment où l’on pense revenir au majeur à la fin du couplet, le morceau continue en mineur. On peut voir là une tentative d’approfondir l’impression de l’auditeur en colorant distinctement l’ensemble du morceau avec les nuances du majeur et du mineur.
Le morceau est composé en intégrant des techniques que j’avais appris à utiliser, comme les accords d’emprunt au mode mineur parallèle, la tierce picarde et les lignes de cliché (cliché lines). Cependant, comme ma maîtrise était déséquilibrée en faveur de la théorie des accords, à la première écoute, cela ressemble presque à une « partition contenant uniquement des accords et une mélodie » avant tout arrangement.
Cela montre mes limites de l’époque ; les techniques d’arrangement faisaient totalement défaut. En même temps, j’étais alors captivé par la « transition des sonorités d’accords », et mon moi de l’époque dirait probablement : « Je voulais simplement entendre résonner les harmonies à nu. »
À cet égard, ce morceau est caractéristique car il exprime succinctement mon approche de la composition à cette époque.
« Hard Worker » (composée en 1991)
Il s’agit d’une œuvre de mes 18 ans, alors que j’entrais dans la vie active. Elle a été produite en utilisant la source sonore FM interne du X68000, un Roland MT-32 et U-220, un KAWAI K4r, et le M3R. Le séquenceur utilisé était l’environnement MML du X68000.
À cette époque, j’avais commencé à m’orienter clairement vers la musique fusion, y mêlant des influences de musique de jeu vidéo, et j’essayais d’exprimer ma propre version d’un « son de groupe » par la programmation.
J’accordais une attention particulière à la basse. À l’époque, j’étais fasciné par le jeu de basse « chopper » (slap) du bassiste Yoshihiro Naruse, et j’utilisais la basse slap dans beaucoup de mes œuvres. Ce morceau démarre d’ailleurs lui aussi par une phrase en slap.
Les mélodies et les phrases d’improvisation étaient inspirées de mes musiques de jeux vidéo préférées, mais je parvenais rarement à leur donner une forme élégante, et j’ai l’impression qu’elles gardaient un côté « brut » ou peu raffiné.
Mais cela aussi, c’était quelque chose que seul le « moi » de cette époque pouvait écrire, et c’était sans aucun doute l’image authentique de ma musique.
Il est également vrai que, tout en composant aussi librement à l’époque, je ressentais un vague sentiment de tomber dans la routine.
Même en composant ce morceau, j’avais le sentiment de le « créer facilement » (dans le mauvais sens du terme), et je trouvais que, bien que la forme soit correcte, il manquait de « passion et de chaleur ».
D’un certain point de vue, on pourrait dire qu’un « modèle » (template) pour ce genre de musique était en train de se former. Cependant, à cause de ce sentiment d’insatisfaction sous-jacent, je n’ai pas poussé cette direction jusqu’à la percée. Au lieu de cela, j’ai piétiné pendant un certain temps, faisant des allers-retours.
Une autre tendance observable dans mes œuvres de cette période est le manque de « dynamique » (push and pull) dans les arrangements.
En d’autres termes, toutes les parties jouaient toujours de la même manière, sans contraste. Chaque partie « s’efforçait » toujours de jouer, avec pour résultat qu’aucune ne se détachait vraiment.
C’est probablement le résultat d’un sentiment obsessionnel, « l’incapacité à supporter les situations avec peu de notes », qui me faisait négliger la topographie sonore globale – les reliefs entre densité et rareté sonore.
Concernant le titre du morceau, il semble qu’à cette époque, la gêne ou la timidité que je ressentais à nommer mes chansons avait disparu, et j’étais capable de m’exprimer plus directement.
Je pense que la raison en était l’émergence d’une certaine fierté en tant que compositeur. J’ai pris conscience que les plaisanteries pour cacher ma timidité étaient en elles-mêmes « ridicules » et constituaient un acte irresponsable de mépris envers l’auditeur.
« Suita Junction » (composée en 1991)
Il s’agit d’une œuvre de mes 18 ans, créée avec la même configuration d’instruments et le même environnement de séquençage que le morceau précédent, « Hard Worker ».
Ce morceau a été composé à une époque où mon attirance pour la musique fusion s’intensifiait, et où l’orientation vers la « reproduction d’une performance live par séquençage » devenait claire.
Peut-être à cause de cela, la « platitude de l’arrangement due à une focalisation excessive sur la théorie des accords », présente auparavant, semble s’être quelque peu estompée. Cependant, comme j’étais toujours obsédé par la conception des harmonies, il semble que je n’ai pas su exploiter le potentiel créatif qui aurait dû s’y trouver.
Pour voir les choses positivement, on pourrait dire qu’en me plaçant sous une certaine contrainte (la priorité à l’harmonie), je me facilitais l’expression d’une créativité inattendue.
Quoi qu’il en soit, dans ce morceau, la tendance à la platitude de l’arrangement est légèrement atténuée. On perçoit une tentative de créer du contraste dans l’espace et l’épaisseur du son, en utilisant un phrasé qui évoque une performance live.
En y repensant aujourd’hui, cela signifie peut-être que je ressentais moi-même divers conflits concernant l’arrangement à cette époque. Au lieu d’empiler les sons ou d’augmenter le nombre de notes sans discernement, j’essayais peut-être de remplir la musique avec la force de persuasion inhérente aux phrases elles-mêmes.
Pour l’anecdote, le titre de cette chanson est tiré de la « Suita Junction sur l’autoroute Meishin » dans la préfecture d’Osaka. J’avais à l’esprit l’image du trafic automobile à cet endroit, célèbre pour ses embouteillages à l’époque. Je devais être fortement attiré par l’atmosphère que dégageait un échangeur autoroutier à grande échelle – ce qu’on pourrait appeler la « pulsation de l’acier ».
« Behind » (composée en 1992)
Le dernier morceau que je présente est celui-ci, une œuvre de mes 19 ans. Il a été produit avec la même configuration d’instruments que « Suita Junction », à laquelle s’ajoute une E-MU Procussion.
Le son de guitare de la carte d’extension Roland SN-U110-07, déjà utilisé dans le morceau précédent, est ici omniprésent en tant que guitare solo.
Ceux d’entre vous qui ont connu le CM-64, le module de son DTM (MAO) qui a fait fureur à l’époque, se souviennent peut-être aussi de cette carte d’extension.
À l’époque, pour reproduire un son de guitare distordue par séquençage, il fallait router la partie de guitare vers une sortie séparée (para-out) et la faire passer par un effecteur externe, ce qui était une approche intimidante pour l’utilisateur DTM moyen. D’un autre côté, les sons prédéfinis (presets) des modules de son MIDI ne proposaient aucune guitare distordue satisfaisante.
Dans ces circonstances, cette guitare distordue, sortie sous forme de carte d’extension, a été accueillie comme une option de haute qualité pour l’époque.
En mettant la main sur un tel outil, mon « orientation vers la reproduction de performances live » s’est encore accentuée, au point que la recréation de la performance de mon « groupe de fusion » personnel est devenue un objectif en soi.
Je m’étais peut-être inconsciemment installé dans une forme de composition où je suivais un certain format technique et me contentais d’y plaquer mes propres phrases. On pourrait dire que j’étais en train de sombrer dans un état de « perte d’originalité » inconsciente.
À cette époque, un ami musicien m’a fait remarquer : « Ça ressemble à de la musique ordinaire. Ce que tu faisais avant était plus intéressant. » Avec le recul, je réalise qu’il avait l’œil vif et qu’il me donnait son opinion honnête et pertinente.
Cela dit, il est également vrai que j’ai beaucoup gagné et appris de cette « orientation vers la reproduction de performances live ».
Au-delà de l’approfondissement évident de ma compréhension des instruments et des techniques de jeu, le fait d’être entré dans le monde de la composition par l’ordinateur m’a fait prendre conscience, à travers cette reproduction du live, de ma propre incompréhension et de ma distance par rapport à la « corporéité de la musique ». Ce fut une expérience précieuse qui m’a aidé à élargir mes horizons musicaux.
Résumé et impressions
J’ai donc présenté cinq morceaux caractéristiques parmi mes compositions d’adolescent. En les regardant avec mon recul actuel, je vois que les tendances essentielles qui perdurent jusqu’à aujourd’hui y étaient déjà en germe.
Il s’agit d’une obsession pour l’harmonie, d’un intérêt pour la conception de la structure temporelle de la musique, et aussi d’une tendance à subordonner les autres éléments à cette « harmonie et structure temporelle ».
Malgré les maladresses techniques ou les changements dans les méthodes d’expression, j’ai l’impression que ces tendances se manifestaient en moi dès le début.
Je pense que ces tendances ne sont pas étrangères au fait que, dès que j’ai commencé à composer, j’ai pratiqué dans un style consistant à « entrer directement les informations de performance dans l’ordinateur ».
Adolescent, je n’utilisais jamais de piano ou d’autre clavier pour composer. Je pensais les mélodies et les progressions d’accords dans ma tête, puis je les saisissais une par une dans l’ordinateur en respectant la grammaire MML.
Pour commencer, je ne savais même pas jouer du clavier à l’époque. Donc, même pour tester une courte phrase, je devais passer par le processus de saisie en MML pour la faire jouer. En y repensant aujourd’hui, je trouve que c’était une méthode incroyablement détournée et fastidieuse.
Cependant, il est certain que cette expérience a affûté mon aptitude à « écouter attentivement le son qui est devant moi ». De plus, j’ai le sentiment que, dans un environnement libéré de l’influence des « habitudes de jeu » (automatismes des doigts), j’ai pu acquérir la compétence de matérialiser méticuleusement les images que j’avais en tête.
Voilà, j’ai exposé ce dont je pouvais me souvenir. J’espère que ce contenu vous sera utile, ne serait-ce qu’un peu.