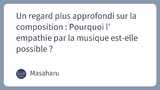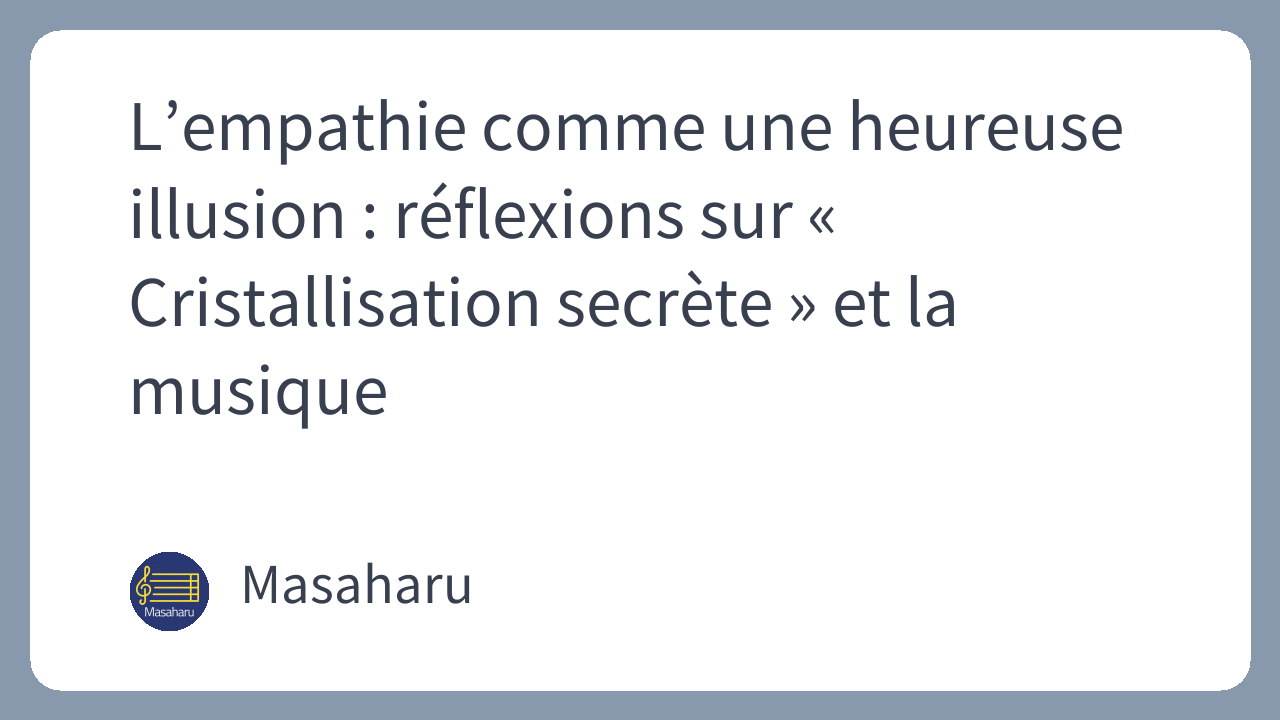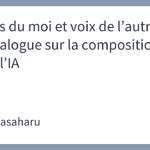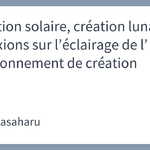J’ai récemment terminé la lecture de « Cristallisation secrète » de Yoko Ogawa.
Cette expérience de lecture a été assez singulière pour moi. Je ne me suis pas fortement identifié aux personnages, et les scènes ne se sont pas dessinées avec une clarté éclatante dans mon esprit. J’étais simplement absorbé, suivant le fil de l’histoire avec une attention tranquille. Pourtant, en refermant le livre, j’ai ressenti un sentiment de plénitude, comme si j’avais saisi la totalité de l’univers du récit. C’était une sorte de « conviction tranquille ».
Cependant, il ne s’agissait probablement que d’une « heureuse illusion ». Comment un lecteur, en tant que tiers, pourrait-il appréhender parfaitement un monde que même les personnages qui y vivent ne comprennent sans doute pas entièrement ? En y réfléchissant, je réalise que cette « vue d’ensemble » que j’ai cru percevoir n’était pas tant une chose offerte par l’auteure qu’une image qui a émergé de la résonance entre mes propres souvenirs, expériences et émotions et les fragments du récit. C’était une image qui s’était secrètement cristallisée dans mon propre esprit. La satisfaction ressentie à cet instant provenait précisément de cette implication de mon monde intérieur.
Cette expérience de lecture fait écho à ma conception du « mécanisme de l’empathie en musique » (voir les articles connexes). On a souvent tendance à croire que l’empathie musicale consiste, pour l’auditeur, à revivre telles quelles les émotions et les intentions du compositeur. Or, en réalité, nous ne pouvons jamais connaître l’intention complète du compositeur, et il n’existe aucun moyen de la vérifier. Malgré cela, en écoutant de la musique, nous nous forgeons notre propre vision d’ensemble et y trouvons de l’empathie.
La musique est un art du temps ; il est impossible d’en saisir la totalité en un seul instant. Les vides au sein d’une œuvre, comme les silences et les résonances, sollicitent activement l’imagination de l’auditeur. Si la musique était un flux sonore ininterrompu et sans interstices, elle deviendrait un torrent d’informations, se rapprochant d’un bruit dénué de sens. Dans ces instants où le son s’interrompt, nous nous demandons : « Que va-t-il se passer ensuite ? » ou « Quel sens puis-je trouver ici ? ». C’est alors que nous faisons appel à notre propre sensibilité, convoquant même les sons ambiants et les souvenirs passés, pour cristalliser notre propre image de la musique.
Ce processus est semblable à l’acte de lire les « mots invisibles » entre les lignes d’un roman. Les espaces, laissés intentionnellement ou fortuitement par le compositeur, éveillent la sensibilité de l’auditeur et lui permettent de reconstruire la « vue d’ensemble » à sa manière. L’image qui en résulte n’est pas, à proprement parler, le plan initial du compositeur. Mais lorsque nous l’acceptons comme « notre vérité », nous faisons véritablement l’expérience de l’empathie. On peut qualifier cela d’illusion, mais n’est-ce pas précisément cette « heureuse illusion » qui constitue l’un des plaisirs les plus profonds de l’expérience artistique ?
C’est ainsi que j’interprète la « conviction tranquille » que j’ai ressentie après avoir terminé « Cristallisation secrète ». Je n’ai pas compris parfaitement l’intention de l’auteure ; c’est plutôt en m’engageant dans l’œuvre que j’ai moi-même attribué un sens, ce qui a permis à « ma propre vue d’ensemble » de se cristalliser. C’est, je crois, la source de ma satisfaction.
Ce même principe s’applique à la composition. Choisir les matériaux, les agencer, façonner le flux musical : ce processus engage la sensibilité et la volonté du compositeur. L’œuvre qui en émerge devient alors une autre « vue d’ensemble » pour l’auditeur, et une nouvelle forme d’empathie naît de la relation entre les deux.
En fin de compte, la lecture, l’écoute musicale et la création sont peut-être toutes des activités mues par notre désir fondamental de « donner du sens ». Et bien que cette quête soit une illusion (heureuse), c’est elle qui relie les êtres humains et permet aux œuvres de traverser le temps. N’est-ce pas là le pouvoir à la fois mystérieux et précieux de l’art ?
Articles connexes