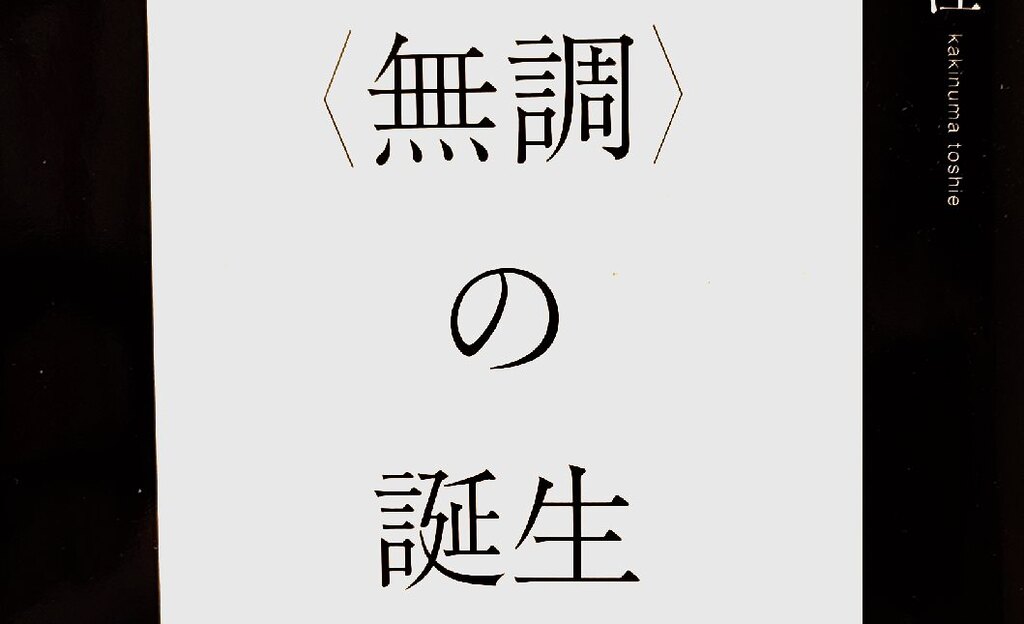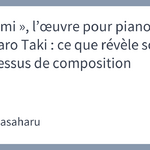Si vous avez appris l’histoire de la musique du XXe siècle comme un récit linéaire où le chromatisme extrême de Wagner a provoqué l’effondrement de la tonalité, à partir duquel Schoenberg a créé la musique atonale qui a évolué vers la technique dodécaphonique, alors ce livre va fondamentalement ébranler votre perspective sur l’histoire de la musique et vous procurer une nouvelle forme d’excitation intellectuelle.
L’ouvrage de Toshie Kakinuma, *La Naissance de l’« atonalité » : L’avenir de la musique à une époque sans dominantes*, remet fondamentalement en question ce « mythe » de l’histoire de la musique que beaucoup d’entre nous ont accepté sans se poser de questions.
Le livre s’ouvre sur une question à la fois très simple et que tout le monde a évitée : d’où vient exactement le mot « atonalité » ?
Étonnamment, ce n’est pas Schoenberg lui-même qui l’a inventé. Vers 1906, c’était un terme né des réactions émotionnelles du public et des critiques qui, trouvant son œuvre trop complexe, la qualifiaient de « non musicale » ou d’« amusicale ». Il s’agissait, en somme, davantage d’une « impression » que d’un terme formel.
Schoenberg, qui sera plus tard surnommé le « fondateur de la musique atonale », détestait profondément cette étiquette. Il qualifiait sa propre musique de « pan-tonalité », estimant que la tonalité n’avait pas disparu mais s’était au contraire élargie pour englober toutes les tonalités, créant ainsi une nouvelle forme plus vaste. C’était une philosophie très originale visant un état musical plus complet, transcendant le dualisme des modes majeur et mineur.
Le livre retrace méticuleusement les origines de ce terme, exposant la fragilité de la vision évolutionniste conventionnelle de l’histoire de la musique qui postule que « la musique tonale s’est effondrée, et qu’une nouvelle musique appelée atonalité est née dans son sillage ».
Cependant, la véritable essence de ce livre va bien au-delà d’une simple reconsidération de la théorie musicale. L’auteure démontre avec une perspicacité remarquable comment le concept d’« atonalité » s’est entrelacé avec la politique et l’éthique en dehors du domaine de la musique.
À l’époque, l’objectif de Schoenberg de « libération des chaînes de la tonalité » a donné naissance à un discours associant « atonalité = liberté » et « atonalité = révolution », qui a été encore amplifié par les courants de l’histoire.
En particulier, le rejet par les nazis de la musique atonale en tant que « musique dégénérée » a paradoxalement ancré profondément chez les musiciens et les intellectuels l’idée que « la musique que Hitler détestait devait être le seul art véritablement sincère et noble ».
Derrière cela se trouvait l’influent musicologue et philosophe Theodor W. Adorno. En tant que fervent défenseur de Schoenberg, il est allé jusqu’à critiquer les compositeurs qui continuaient à écrire de la musique tonale, les qualifiant de « réactionnaires ». Pour Adorno, ce n’était pas simplement une question de goût musical, mais un impératif éthique pour quelqu’un qui avait vécu les atrocités du nazisme.
Se dessine alors le portrait d’une époque où, sous une telle pression politique, de nombreux compositeurs se sont « convertis » à la technique dodécaphonique contre leur gré ou ont ressenti une contrainte palpable.
C’est un rappel qui donne à réfléchir sur la manière dont l’acte de création musicale est inextricablement lié aux influences de son temps et de sa société. L’anecdote selon laquelle le violoncelliste Julian Lloyd Webber aurait déclaré plus tard, lors d’une conférence à Davos, que « la « musique atonale », interdite par Hitler, persécute maintenant paradoxalement la musique tonale » symbolise de manière frappante cette situation absurde.
Si la vision conventionnelle de l’histoire est erronée, comment devrions-nous réévaluer la musique du XXe siècle ? L’auteure, Toshie Kakinuma, soutient que « la tonalité ne s’est pas effondrée ; elle s’est étendue ».
En abandonnant la dichotomie « atonalité contre tonalité », nous prenons conscience que des compositeurs « tonals » jusqu’alors négligés, comme Sibelius et Britten, élargissaient en réalité les possibilités de la tonalité par le biais de nouvelles techniques et de structures temporelles cycliques.
De plus, l’analyse des premières œuvres de Penderecki, révélant que « même au sein d’œuvres d’avant-garde en apparence radicales se cachaient des structures temporelles traditionnelles », nous enseigne l’importance de regarder au-delà des styles de surface pour saisir l’essence véritable du travail d’un compositeur.
Ce livre illustre de manière saisissante comment la musique du XXe siècle et au-delà a formé un paysage diversifié et riche, plutôt que de converger vers un unique courant historique dominant.
Comme nous l’avons vu, *La Naissance de l’« atonalité »* est un livre d’aventure intellectuelle qui reconstruit les connaissances existantes.
La lecture de ce livre — que vous soyez un mélomane, un créateur ou un chercheur — sera pour vous une expérience de démantèlement et de reconstruction de votre propre cadre de compréhension.
Le récit, qui retrace l’histoire de manière inversée, se demandant si l’« atonalité » a même jamais existé, prend des allures de mystère ou de documentaire de grande qualité, guidé par la plume détaillée de l’auteure.
Une fois la lecture terminée, vous vous surprendrez à écouter la musique du XXe siècle et des périodes suivantes avec une perspective différente, armé de l’inspiration nécessaire pour forger une nouvelle vision de ce que la musique peut être.
Informations complémentaires sur le livre
Titre (japonais) :『〈無調〉の誕生』
Auteur :柿沼 敏江 (著)
ISBN : 4276132053
Table des matières de « La Naissance de l’atonalité »
- Prologue – Une époque sans dominantes
- Chapitre 1 : Qu’était-ce que l’« atonalité » ?
- Le terme atonalité / Qu’est-ce que l’atonalité ?
- Chapitre 2 : Relire Schoenberg
- L’« Erreur de Schoenberg » / La conviction de Schoenberg / La mono-tonalité / Tonalité et genre / La plante originelle de Goethe
- Chapitre 3 : Entre atonalité et tonalité
- La tonalité émergente / La tonalité dans la musique dodécaphonique
- Chapitre 4 : La rhétorique de l’atonalité et de la tonalité
- Du non-art à la folie / La mort de la tonalité / L’inquiétante étrangeté / Liberté et libération / Atonalité et révolution / Sincérité et éthique
- Chapitre 5 : La « conversion » de Krenek (La politique de l’atonalité 1)
- L’art politique / Le chemin vers « Charles Quint » / Correspondance avec Adorno / « Charles Quint » et la technique dodécaphonique / Une technique dodécaphonique singulière / Technique dodécaphonique et tonalité / Rotation et modalité / La technique dodécaphonique comme refuge
- Chapitre 6 : Un autre Darmstadt (La politique de l’atonalité 2)
- Critique de la musique d’avant-garde / L’Heure Zéro comme point nodal / Hermann Heiss et la technique dodécaphonique / Herbert Eimert et la musique atonale / Golychev, Hauer et le sérialisme / L’image construite de Webern
- Intermezzo – Nicolas Nabokov et l’« atonalité »
- Chapitre 7 : Le courant caché – La magie de la gamme octatonique
- Entre la gamme chromatique et la gamme diatonique / La gamme par tons / La gamme octatonique / La gamme médiatrice / Gamme octatonique et chromatisme / Modes à transpositions limitées / La gamme octatonique et la musique contemporaine japonaise / La gamme octatonique et le spectralisme, post-spectralisme / La gamme octatonique et la musique expérimentale, le jazz
- Chapitre 8 : Les circuits de la tonalité
- Critique de la tonalité – Le problème Sibelius / Musique contemporaine pour le peuple – Hanns Eisler / Classique léger (ou la tonalité comme Dada) – Kurt Schwertsik / L’esthétique « post » (ou la musique comme post-scriptum) – Valentin Silvestrov
- Chapitre 9 : Le monde créé par le tempérament et les harmoniques
- Écart par rapport au tempérament égal à douze tons – Tiers de ton et quarts de ton / La tonalité basée sur l’intonation juste – Shōhei Tanaka, Harry Partch / Un regard vers les harmoniques – Stockhausen et Ligeti / Musique spectrale et « atonalité » / L’expansion des harmoniques – Tenney, Radulescu, et autres
- Chapitre 10 : L’orbite du temps
- Ce qui crée l’axe du temps / Traces de narration – Schoenberg, Penderecki / Le temps épisodique – Satie, Stravinsky, Feldman / La géométrie du temps – Sérialisme et musique spectrale / Le temps cyclique – Passacaille et structures rythmiques en racine carrée
- Épilogue – Le présent sans centre
- Postface
- Bibliographie
- Notes
À propos de l’auteur
Toshie Kakinuma
Née dans la préfecture de Shizuoka. Elle a obtenu son doctorat à l’Université de Californie à San Diego, avec une thèse sur Harry Partch.
Parmi ses publications, on compte « La musique expérimentale américaine était une musique ethnique » (Film Art Sha, 2005). Ses traductions majeures incluent « Silence » de John Cage (Suiseisha, 1996), « Les problèmes de l’identité culturelle » édité par Stuart Hall et al. (co-traduction, Omura Shoten, 2000), « Œuvres choisies d’Alan Lomax » (Misuzu Shobo, 2007), ainsi que « The Rest Is Noise » d’Alex Ross (Misuzu Shobo, 2010, lauréat du prix Music Pen Club Japan) et « Listen to This » (Misuzu Shobo, 2015).
Ses articles comprennent « Les activités des Lomax, père et fils : de la « chanson folklorique » à la « cantométrie » » dans « La musique du monde du point de vue de la chanson folklorique : à la recherche de la géomythologie du chant », édité par Shuhei Hosokawa (Minerva Shobo, 2012).
Elle a été professeure à la Faculté de Musique de l’Université des Arts de la Ville de Kyoto jusqu’en mars 2019 et est actuellement professeure émérite. Elle est également une maître certifiée (natori) de l’« Ichigenkin », un koto à une corde devenu populaire à l’époque d’Edo et dont la tradition perdure aujourd’hui. (Citation du livre)