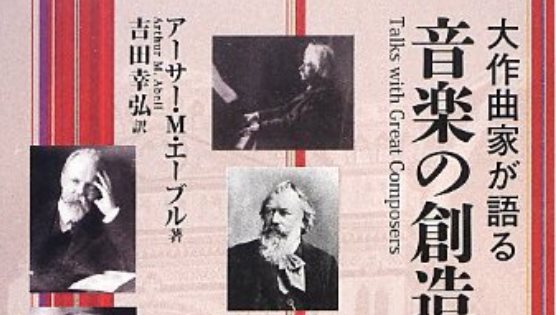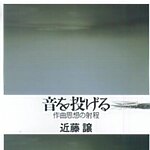(Publié initialement le 23 janvier 2009)
(*Ce livre est une version révisée et rééditée de « Je t’enseignerai ce que tu dois faire ». Le texte suivant a été écrit sur la base de l’édition précédente.)
Ce livre contient de précieuses interviews de compositeurs renommés de la fin du XIXe siècle, tels que Brahms, R. Strauss et Grieg, leur posant la question de l’« inspiration ».
À première vue, le contenu et les expressions peuvent sembler purement anachroniques. Cependant, c’est un travail laborieux qui aborde de front la question de ce qui se passe à l’intérieur d’un compositeur lorsqu’il compose. Les compositeurs présentés parlent dans leurs propres mots de la source de leurs éclairs de génie, de leur inspiration et de leur créativité.
En tant que recueil de paroles de compositeurs de cette époque sur ce thème même, on peut dire qu’il s’agit d’une ressource précieuse sur le plan documentaire.
Cependant, étant donné qu’il s’agit de personnes issues du monde chrétien, des éléments théologiques sont fortement présents en arrière-plan, de sorte que les lecteurs japonais pourraient trouver certaines parties difficiles à assimiler. Mais en interprétant celles-ci de manière large comme un sentiment de foi et en lisant sous l’angle d’une crainte respectueuse envers un être transcendant, je crois qu’il est possible de comprendre leur attitude envers la création.
◇
Le sous-titre est « Quand les compositeurs reçoivent l’inspiration », ce qui donne d’emblée une impression spirituelle. Cependant, comme le note également le traducteur, je crois que l’on peut comprendre le thème principal en lisant « reikan » comme « inspiration ». En d’autres termes, qu’est-ce qu’un « éclair de génie » et d’où vient-il ?
Brahms dit : « Je suis dans un état de transe, errant entre le sommeil et l’éveil. Je suis encore conscient, mais sur le point de le perdre, et c’est à de tels moments que me viennent les idées inspirées. Toute véritable inspiration vient de Dieu, et ce n’est qu’à travers le rayonnement de la divinité intérieure que Dieu peut se révéler. Ce rayonnement, les psychologues modernes l’appellent le subconscient. »
—La lecture de cette citation et d’autres expressions similaires rappelle ce que Csikszentmihalyi appelle l’« état de flux » (flow state). Cet état de flux accompagne généralement les résultats d’activités mentales réalisées grâce à des niveaux élevés de concentration ou d’immersion. Il est différent de l’excitation, de l’ivresse ou de la frénésie ; c’est plutôt l’état de conscience opposé.
Concernant le processus d’émergence des idées, « Une technique pour produire des idées » de James Webb Young est célèbre en tant que guide dérivé de l’empirisme. Il semble également que les neurosciences considèrent comme valide le processus d’« une période de réflexion approfondie sur le thème », « une période d’oubli » et « le moment d’un « éclair » d’une nouvelle idée ».
En lisant ce livre, j’ai eu l’image qu’une œuvre naît comme le résultat heureux de la fusion de l’état de flux de l’immersion dans la tâche à accomplir, de la délibération approfondie et de son oubli (mise de côté temporaire), et d’une « haute compétence technique », qui a tendance à être sous-estimée dans les domaines qui mettent l’accent sur les « éclairs de génie ».
Les paroles de Brahms, « Je veux que vous réalisiez que si vous souhaitez écrire quelque chose de valeur éternelle, vous avez besoin à la fois d’inspiration et de savoir-faire », soulignent la nécessité d’une compétence avancée pour incarner l’inspiration, parallèlement à son importance. Lorsque je réfléchis à la posture créative de Brahms, je ressens également sa frustration et son chagrin envers le monde de la composition de son temps.
Cependant, le pouvoir de ce livre ne vous laisse pas vous arrêter à de telles impressions. Ce qui était frappant, c’est que Brahms et R. Strauss ont tous deux déclaré, en des termes différents, que « seuls quelques pourcents des compositeurs composent avec inspiration ».
« Écrit uniquement avec l’esprit conscient. Purement créé dans la tête, totalement dépourvu d’inspiration » – de telles œuvres, disent-ils, sont vite oubliées, citant cela comme la raison de l’échec des œuvres des compositeurs populaires de l’époque. Derrière cela se cache une révérence pour le « pouvoir de quelque chose qui dépasse l’entendement humain » que possède la bonne musique, et pour les êtres (Dieu, les Muses) qui l’apportent. C’est peut-être pour cette raison qu’un sentiment d’« humilité » se dégage constamment des paroles des compositeurs présentés.
Il sert d’avertissement contre le fait de tomber dans le genre de composition qui se contente de manipuler superficiellement des compétences existantes pour créer « quelque chose qui a la forme de la musique ». En même temps, il nous ramène à l’humilité de sentir que ce n’est pas moi, le compositeur, qui crée la musique, mais que je suis autorisé à participer à « un lieu où le pouvoir de la musique se manifeste ».
Il est facile de relativiser et de prendre ses distances avec ce type de livre d’un point de vue historique ou culturo-historique, mais pour ma part, j’ai ressenti une attraction difficile à rejeter, difficile à abandonner. En réfléchissant au sens littéral et à la signification de la « création », il est peut-être inévitable, d’une certaine manière, de se confronter au domaine que ce livre aborde.
Informations complémentaires sur le livre
Titre (japonais) :『大作曲家が語る 音楽の創造と霊感』
Auteur :アーサー・M・エイブル (著), 吉田 幸弘 (翻訳)
ISBN : 4915884686
Table des matières de « Entretiens avec les grands compositeurs »
- En guise de « Préface » / Introduction / De l’éditeur / Remerciements
- Johannes Brahms
- Chapitre 1
- Brahms et Joachim parlent de l’inspiration
- Brahms prend Beethoven comme guide
- Comment Brahms communiait avec Dieu
- Brahms prend Mozart comme modèle
- Brahms et l’invocation à la Muse
- Brahms, religieux mais peu orthodoxe
- Brahms cite Matthieu VII, 7
- Comment Lao-Tseu a atteint la divinité
- Chapitre 2
- Brahms et les miracles de Jésus
- Daniel Home marche dans les airs
- Les pouvoirs psychiques de Daniel Home à Paris
- Blind Tom et Zerah Colburn
- La biographie de Daniel Home
- Chapitre 3
- L’opinion de Brahms sur l’athéisme
- Brahms fasciné par le concept de création de Tennyson
- Tennyson discute de la création avec Darwin
- Brahms rend hommage à la vision de Tennyson sur l’âme immortelle
- Chapitre 4
- Brahms s’intéresse à la ville natale de l’auteur
- La reine Victoria et Sitting Bull
- Brahms, Tartini et le Diable
- Brahms rend hommage à Shakespeare et Milton
- Chapitre 5
- Pourquoi Brahms croyait en l’immortalité
- Brahms et l’invocation à la Muse de Milton
- Brahms souligne l’importance de l’isolement
- Chapitre 6
- La plupart des compositeurs peinent en vain
- Brahms critique la myopie de Spohr
- La définition du génie par Brahms
- Ce que Brahms voyait dans ses humeurs exaltées
- Brahms, Wilamowicz et le larron sur la croix
- Brahms promet le secret pendant cinquante ans
- Chapitre 7
- Comment Joachim a réagi au témoignage de Brahms
- Joachim analyse les détracteurs de Brahms
- Un aperçu de la biographie de Brahms
- Chapitre 1
- Richard Strauss
- Chapitre 8
- Weimar et Strauss en 1890
- Avec Strauss chez lui
- Strauss sur la source de l’inspiration
- Strauss entend l’inspiration diriger « Tannhäuser »
- Weimar – un centre culturel dans les années 1890
- Rencontre avec la première Elsa et Telramund
- Une femme de dignité
- La gratitude d’un compositeur
- Une scène historique
- Chapitre 9
- R. Strauss sur Alexander Ritter
- Strauss conteste Emerson
- La réaction de Lassen à « Don Juan »
- Audition du premier opéra de Strauss, « Guntram »
- Quand Strauss composait « Salomé »
- Chapitre 10
- Première de « Der Rosenkavalier » à Dresde
- Première de « Ariadne auf Naxos » à Stuttgart
- Les dernières années de Strauss
- Chapitre 8
- Giacomo Puccini
- Chapitre 11
- Rencontre avec le compositeur de « La Bohème », « Tosca » et « Madame Butterfly »
- Le fiasco de la première de « Madame Butterfly »
- Puccini sur la façon dont il a atteint la divinité
- La mise en scène de Puccini pour « La Bohème »
- Chapitre 12
- La Tour d’Ivoire (Torre del Lago) et le Maestro
- Comment Puccini a composé « La Bohème »
- L’hommage vibrant de Puccini à Toscanini
- Musique en désaccord avec le livret
- Puccini accentue la tristesse avec une tonalité majeure
- Chapitre 13
- Le caractère fondamental des Italiens
- Puccini sur le processus de composition de « Tosca »
- Comment la pièce « Madame Butterfly » a fasciné Puccini
- Chapitre 11
- Engelbert Humperdinck
- Chapitre 14
- Humperdinck sur le processus de composition de Wagner
- Wagner s’inspire de Shakespeare
- Humperdinck se déprécie en tant que compositeur
- Chapitre 14
- Max Bruch
- Chapitre 15
- Max Bruch et le Concerto pour violon en sol mineur
- Max Bruch sur l’inspiration
- L’appréciation de Brahms par Bruch
- Max Bruch dans ses dernières années
- Chapitre 15
- Edvard Grieg
- Chapitre 16
- Edvard Grieg et l’idiome norvégien
- Ole Bull libère Grieg de l’influence de Niels Gade
- Jadassohn taquiné par ses élèves
- Chapitel 17
- Jadassohn critique les méthodes de Grieg
- La réaction de Grieg à la critique de Jadassohn
- La réaction de Grieg aux vues de Brahms
- L’impression de Grieg sur le jeu d’Ole Bull
- Grieg cite l’hommage de Longfellow à Ole Bull
- Grieg refuse un concert pour un cachet de 25 000 dollars pour une seule représentation
- Chapitre 16
- Conclusion
- Notes du traducteur / Postface du traducteur / Bibliographie / Liste des versets bibliques / Index des noms
À propos de l’auteur
Arthur M. Abell
L’auteur, Arthur M. Abell, est issu d’une famille de journalistes et est lui-même devenu correspondant musical pour le « Musical Courier ». En 1890, à l’âge de vingt-huit ans, il est affecté à Vienne. Il était également un violoniste amateur, parlait couramment l’allemand et l’italien, et entretenait des amitiés avec de nombreux interprètes et critiques musicaux à Boston et à New York. Parmi eux figuraient Arthur Nikisch, chef d’orchestre du Boston Symphony Orchestra, Walter Damrosch, chef d’orchestre du New York Philharmonic, et Philip Hale, un éminent critique musical de la côte Est.