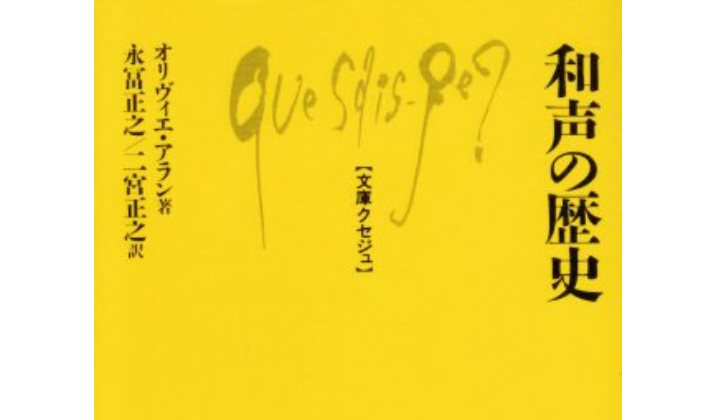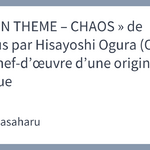(Publié initialement le 10 avril 2002)
L’harmonie, ou « wasei » en japonais, se traduit par « concorde ». Ce livre ne se contente pas de considérer l’harmonie dans le seul cadre de l’harmonie fonctionnelle (harmonie tonale), mais retrace son histoire en tant qu’élément qui exprime et régit cette concorde. Pour reprendre les termes du livre, il s’agit d’essayer de voir l’harmonie comme une longue ligne continue qui traverse l’histoire de la musique.
Ce parcours historique commence au Xe siècle, voire vers les Ve-VIe siècles si l’on inclut l’esquisse générale. La première forme d’harmonie observée est ce que l’on pourrait appeler une « harmonie d’intervalles », où des mélodies se déplacent en parallèle, maintenant constamment une relation de quartes et de quintes. Le livre commence à retracer l’histoire de l’harmonie à partir de ce point.
Les pages se tournent plus vite lorsque l’on atteint la section qui dépeint la transformation du crépuscule de la tonalité à sa saturation et sa transcendance. Il le fait en mettant en lumière les différences individuelles entre les compositeurs des XVIIIe et XIXe siècles – quels éléments de l’harmonie tonale ils ont vivement développés et, inversement, lesquels ils n’ont pas développés. Le rythme de l’écriture, combiné au sujet, en fait une partie captivante du livre.
Par exemple, dans une section intitulée « Modalité et Tonalité », l’auteur souligne que de nombreux compositeurs russes et français du XIXe siècle ont intégré la modalité dans la tonalité conventionnelle (traditionnelle), les faisant coexister. En d’autres termes, la modalité était utilisée comme un élément pour repousser habilement l’oppression exercée par la tonalité.
Cette quête de la modalité ne se retrouve pas en Allemagne à la même époque, où un chromatisme approfondi les a conduits plus tôt à un « état de saturation sonore », via la polytonalité. En France et ailleurs, cependant, l’utilisation des modes et de la polymodalité a fait que l’émergence d’une musique donnant une impression de saturation similaire est arrivée un peu plus tard.
De plus, dans la section suivante « Le crépuscule de la tonalité », l’auteur cite la « dissimulation, l’enfouissement et l’oubli de la tonalité » par le biais de matériaux modaux et de techniques d’orchestration comme une caractéristique harmonique des œuvres de Debussy. Il affirme que, bien que son squelette harmonique se conforme (de manière limitée) à la tonalité modale, Debussy a enrichi l’harmonie en utilisant la polymodalité et la polytonalité, en empruntant des accords de IV, I et V à divers modes et en évitant le mouvement de la note sensible. Ceci, dit-il, a ouvert la voie aux techniques de Messiaen.
Or, une chose que les excellents livres d’histoire ont en commun est un sens habile de la perspective lorsqu’ils se concentrent sur les personnages et les événements. Au moment où l’on pense qu’ils ont zoomé sur des détails personnels et infimes, ils élèvent instantanément le lecteur à une hauteur qui permet une vue d’ensemble des situations sociales et culturelles, laissant une impression à multiples facettes.
En ce sens – en procurant une « expérience historique » à travers une prose apparemment vertigineuse, mais contrôlée et sobre – il n’est pas exagéré de dire que cette « Histoire de l’harmonie » est l’un de ces excellents livres d’histoire.
Cependant, il convient de noter que ce livre s’adresse à un lectorat averti, car le plaisir sera diminué de moitié si l’on ne possède pas une compréhension raisonnable des termes techniques centrés sur les intervalles.
Ainsi, ce livre est très suggestif, offrant un aperçu de « la manière dont les compositeurs de chaque époque ont abordé et traité l’harmonie ». Comme on le dit souvent, « les sages apprennent de l’histoire, les sots de leur expérience ». Parallèlement à l’apprentissage tiré de nos activités musicales quotidiennes, nous devrions également nous efforcer d’apprendre beaucoup de l’histoire de la musique.
Informations complémentaires sur le livre
Titre (japonais) :『和声の歴史 文庫クセジュ』
Auteur :オリヴィエ アラン (著), 永冨 正之 (翻訳), 二宮 正之 (翻訳)
ISBN : 4560054487
Table des matières de « L’Histoire de l’harmonie »
- Préface du traducteur / Au lecteur japonais / Avant-propos
- Chapitre I : Esquisse générale
- Signes et abréviations / Définition des termes techniques / Modes / Accords
- Chapitre II : De l’intervalle à l’accord
- Origines / Du Xe au XIIe siècle / XIIIe siècle / XIVe siècle / XVe siècle
- Chapitre III : De l’accord à la tonalité – L’harmonie de la Renaissance (XVIe-XVIIe siècle)
- Résumé / Consolidation des modes en majeur et mineur / Caractéristiques du majeur et du mineur / Influence de la musique instrumentale / Problèmes de tempérament / Basse continue et harmonie improvisée / Développement / Musiciens avant 1722
- Chapitre IV : L’harmonie tonale – Deux siècles de musique à tempérament égal, expansion et synthèse (XVIIIe-XIXe siècle)
- Résumé / Nouvelles découvertes / La théorie de Rameau / Diverses considérations / La conquête de l’espace à tempérament égal / Fugue et plan tonal / L’harmonie des musiciens représentatifs (XVIIIe s.) / Idem (XIXe s.) / Modalité et tonalité / Le crépuscule de la tonalité
- Chapitre V : Saturation et transcendance
- Bilan final – La rationalisation ultime de l’harmonie des hauteurs / Aspects de la phase finale de développement / Saturation de l’espace à tempérament égal / Transcendance de la série – Microtonalité
- Chapitre VI : Perspectives
- Conclusion / Bibliographie
À propos de l’auteur
Olivier Alain
L’auteur, Olivier Alain, est né le 8 août 1918 à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Il est issu d’une famille de musiciens ; son père était organiste, et ses frère et sœur étaient le compositeur Jehan Alain, mort jeune, et l’organiste Marie-Claire Alain. Après la Seconde Guerre mondiale, il entre au Conservatoire de Paris, où il obtient les premiers prix dans les classes de composition et d’analyse. Il est actuellement directeur de l’École César-Franck, tout en étant critique musical pour le journal Le Figaro, et est actif dans de nombreux domaines. (Cité de ce livre)