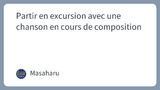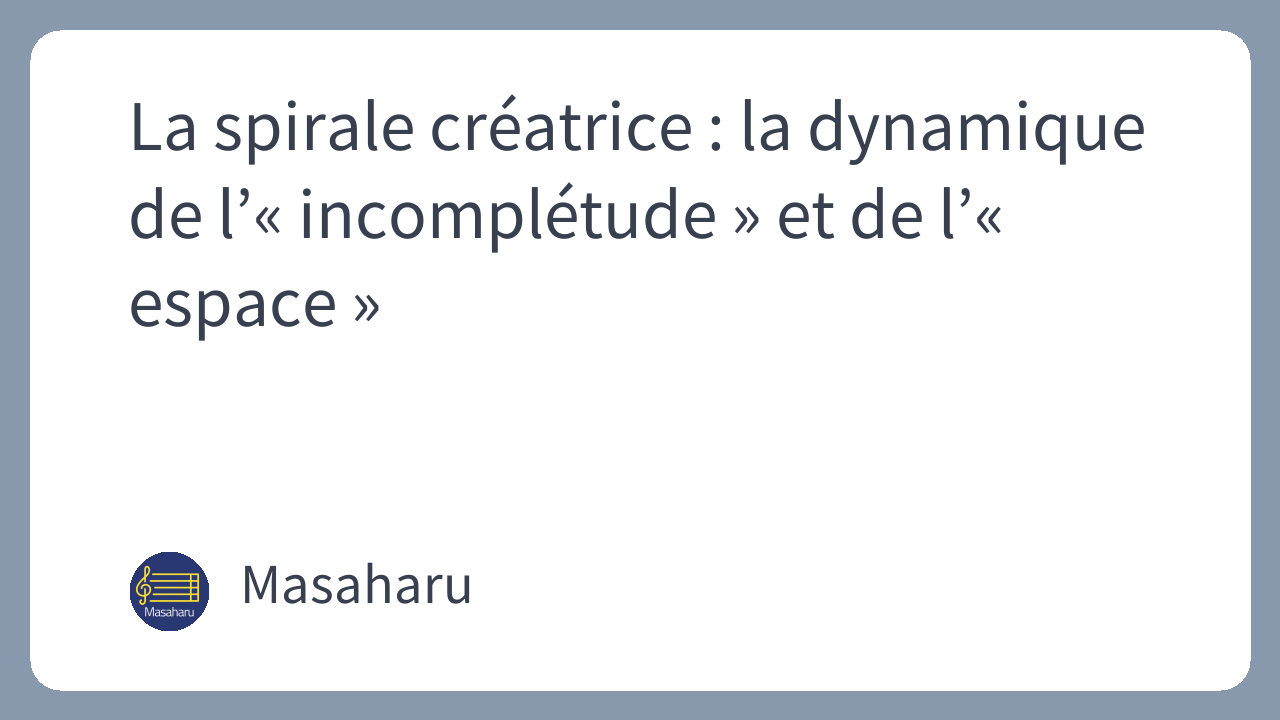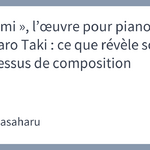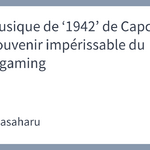Il semble que de nombreux créateurs, y compris moi-même, soient inconsciemment prisonniers de la « malédiction de l’acharnement ». Ne percevons-nous pas la production musicale comme un marathon, une course vers la ligne d’arrivée sans un instant de répit ni un regard de côté ? Si c’est le cas, cela provient peut-être d’une certaine conviction selon laquelle « travailler avec acharnement et ardeur » serait directement lié à la qualité de l’œuvre.
Cependant, il serait hâtif de rejeter cet « acharnement » comme étant entièrement négatif. Je pense plutôt qu’il est l’expression d’une phase d’« incomplétude », une étape indispensable du cycle de création. Cette phase interagit avec l’« espace » qui lui succède pour former un processus dynamique menant à un niveau de création supérieur.
Dans cet essai, je considérerai donc cette période d’incomplétude, à l’origine de notre acharnement, comme l’« inspiration de la création », et l’espace qui en découle comme l’« expiration de la création ». À travers une perspective introspective, j’explorerai la dynamique de la « spirale créatrice » tissée par ces deux états.
L’inspiration de l’« incomplétude » : immersion dans la vérité musicale
Pour un créateur, le cycle de création s’amorce souvent par un sentiment d’« incomplétude ». Ce terme ne désigne pas une simple absence de compétence, mais plutôt le fossé intellectuel et sensible qui sépare ce qui est (notre moi actuel) de ce que nous imaginons comme idéal (la musique encore inouïe). C’est une soif insatiable.
En s’attaquant à une nouvelle idée musicale ou à une forme inédite, le compositeur éprouve presque toujours un sentiment d’insuffisance de ses propres capacités et une impatience face à sa vision qui ne parvient pas à se matérialiser en son. Cet état intérieur constitue le cœur même de l’« acharnement » que nous investissons dans la production musicale. Bien que cette lutte soit mentalement éprouvante, elle agit également comme une force propulsive nous poussant vers l’étape suivante. Poussés par le désir de la « musique encore inouïe », nous explorons la vérité musicale au-delà d’une simple suite de notes – un processus inévitablement accompagné de cet acharnement.
Cette période d’« incomplétude » peut être qualifiée d’« inspiration » musicale. Elle consiste à absorber avidement divers éléments extérieurs et à les accumuler intérieurement. Cela implique une concentration intense et introvertie : explorer la polysémie d’un seul accord harmonique, rechercher l’expression la plus juste d’une émotion dans le phrasé, ou insuffler la vie dans les subtiles fluctuations du rythme. Sans traverser cette phase de recherche et d’insatisfaction, il est difficile d’atteindre de nouvelles perceptions ou une expression musicale singulière.
L’expiration de l’« espace » : intégration et regard objectif
Après une période de recherche acharnée, prendre de la distance avec son œuvre permet au créateur de cultiver un « espace » intérieur. C’est cet espace, je crois, qui devient la force capable de lier organiquement les fragments épars pour les sublimer en une forme musicale unifiée.
L’une des manières de créer cet espace est une pratique que j’ai autrefois décrite comme « partir en excursion avec un morceau en cours de composition ». Cette approche consiste à s’éloigner temporairement de l’environnement de production pour acquérir une perspective différente, approfondir l’introspection et retrouver un regard objectif sur l’œuvre, tout en s’y engageant plus profondément. Des activités qui peuvent sembler futiles ou constituer un détour, comme se promener ou s’immerger dans un art totalement différent, nourrissent en réalité cet espace intérieur et agissent comme une « expiration » qui insuffle un vent nouveau à l’ensemble de l’œuvre.
Ce temps de l’« espace » n’est ni un simple repos ni une fuite. C’est un lieu intellectuel où les connaissances et expériences fragmentées, qui n’étaient pas au premier plan de la conscience pendant la production, s’intègrent en profondeur. Ce n’est qu’en prenant du recul par rapport à la ferveur créatrice pour contempler l’ensemble, ou en marquant une pause pour renouer le dialogue avec l’œuvre, que l’on peut percevoir la valeur des « vides » invisibles dans un état d’acharnement – comme le silence entre les notes ou la place laissée à l’expression.
Au sommet de cet « espace » se trouve ce que l’on pourrait appeler une forme de résignation, fondée sur la reconnaissance de la finitude humaine et la compréhension que la perfection ou l’idéal sont inatteignables, tout en continuant à persévérer. C’est une attitude qui nous libère discrètement de la malédiction de la quête de l’œuvre parfaite. La posture saine qui consiste à décider que « cette œuvre n’est pas parfaite, mais c’est le meilleur que je puisse offrir pour le moment » et à la livrer au monde n’est pas un abandon de la créativité. Au contraire, cette « résignation » s’apparente à un nouveau point de départ, nous permettant de passer à la création suivante sans sacraliser excessivement l’œuvre.
Dessiner la « spirale créatrice »
En fin de compte, pour le créateur, la création est peut-être un processus dynamique et en spirale, répétant deux phases : l’inspiration de l’« incomplétude » et l’expiration de l’« espace ».
Dans l’état d’incomplétude, nous absorbons avec avidité de nouvelles connaissances et techniques. Dans la période d’espace qui s’ensuit, nous les intégrons et les évaluons objectivement. En répétant ce cycle, nous ne faisons pas qu’améliorer nos compétences techniques ; nous accomplissons également une croissance intellectuelle et sensible intérieure, nous permettant de produire des œuvres d’une plus grande profondeur.
Ce processus, tel une spirale montant vers des sommets toujours plus élevés, se poursuit de manière constante, même s’il est invisible à l’œil nu.
Articles similaires