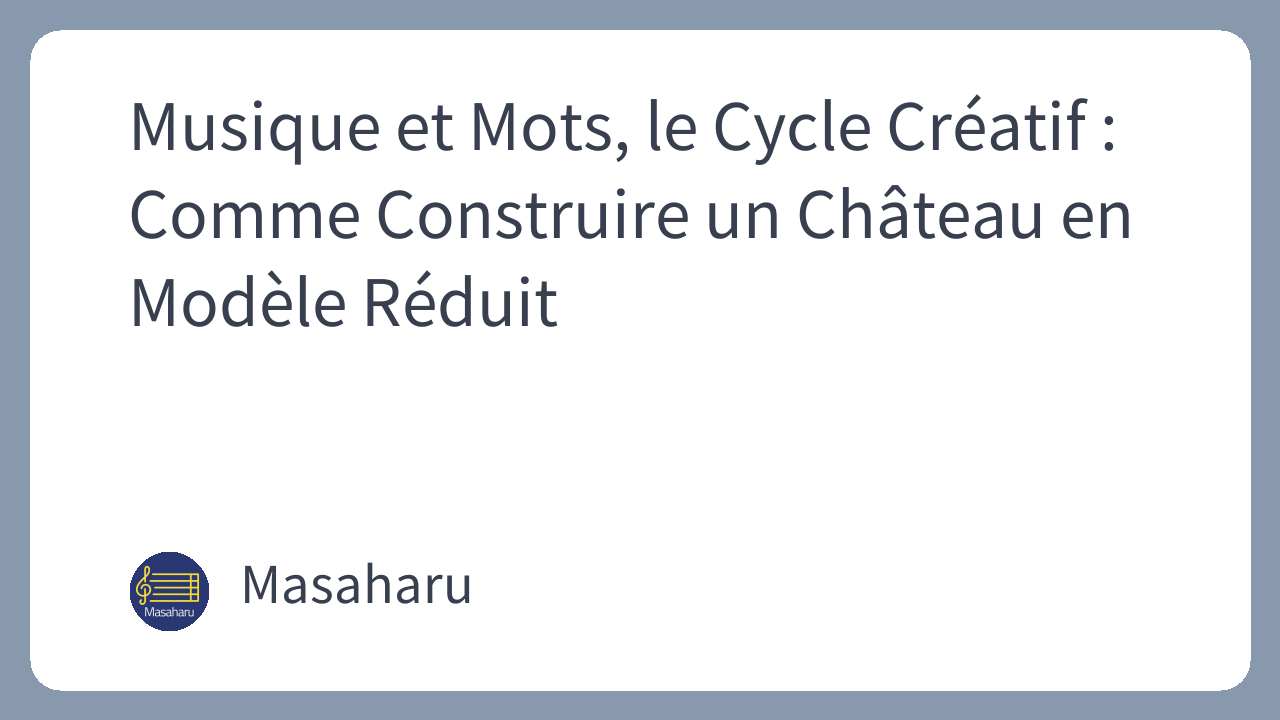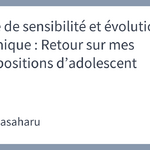Lorsqu’un créateur de musique écrit « à propos de la musique », quelles pensées lui traversent l’esprit ?
Dans mon cas, je connais la puissance immense et intraduisible que je ressens face à la musique – quelque chose qui, par essence, ne peut être mis en mots. C’est précisément parce que je sais cela que j’ose tisser des mots.
C’est un acte qui s’apparente peut-être moins à essayer de saisir la lumière éblouissante elle-même qu’à tracer méticuleusement les contours de l’ombre qu’elle produit.
Qu’est-ce que la musique ? Qu’est-ce que la composition ? En posant ces questions et en tentant de les verbaliser, je suis paradoxalement contraint de me tenir au point où je dois admettre la nature intrinsèquement non verbale de la musique elle-même. Mes « écrits sur la musique » pourraient être décrits comme des croquis ou des abstractions dessinés au bord du précipice de la vaste entité qu’est la musique.
Wittgenstein a dit un jour : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » Cependant, comme le suggère l’anthropologue de l’art Satoshi Nakajima, peut-être que tout en gardant le silence sur ce que nous ne pouvons pas dire, nous *pouvons* verbaliser « l’indicibilité de l’indicible ».
Se tenir au bord de l’abîme du silence, se demander pourquoi c’est un abîme, et parler. Je crois que c’est aussi une attitude sincère pour quiconque est impliqué dans la création.
Pour moi, l’expérience musicale acquise par la composition est unique ; elle me fait ressentir la puissance indéniable et les qualia (textures) de la musique. Les mots inspirés par cette expérience prennent, pour ainsi dire, le caractère d’une création secondaire.
Le texte qui naît ainsi n’est pas simplement subordonné à la musique, et encore moins une conversion de celle-ci. Il est plutôt comme un « satellite » capturé par la gravité de la planète musique, mais traçant sa propre orbite – une création indépendante à part entière.
Ainsi, cet acte de verbalisation finit par s’établir comme l’un de mes propres actes créatifs. J’écoute attentivement la musique, je la contemple intensément, et à partir de là, je combine et assemble les mots qui émergent, construisant (composant) le texte comme un objet unique.
Composer de la musique, écrire du texte, et accumuler ces créations sous ma propre persona pour former une *forme* singulière. Toute cette entreprise est pour moi remplie d’une excitation semblable à la construction d’un « modèle réduit de château », symbolisant l’ensemble de mon activité créatrice.
Je suis fasciné par cette activité méta-créative, où l’on peut percevoir et savourer l’esthétique et l’attachement qui résident dans les détails de cette forme, l’harmonie et les distorsions de l’ensemble, et les qualia uniques évoqués par cette forme.
En y réfléchissant davantage, cela peut être vu comme la construction d’un « système d’observation de son propre processus créatif » de l’extérieur. En d’autres termes, en combinant différents modes d’expression – la musique et les mots – cela pourrait devenir un « appareil expérimental d’observation » pour améliorer sa propre créativité.
À l’intérieur de cet appareil, il y a deux versions de moi-même. L’une est le « praticien » qui compose la musique. L’autre est « l’observateur » qui regarde le comportement du praticien depuis une perspective méta, l’enregistre, et cherche la prochaine direction créative et la nourriture nécessaire.
Ce faisant, on remarque que ce système commence à prendre l’apparence d’un organisme vivant. Le concept biologique d’« autopoïèse » (autoproduction) pourrait bien convenir ici.
La pratique de faire de la musique fait naître des questions qui exigent une verbalisation, telles que « Qu’ai-je créé (qu’est-ce que c’est) ? » Puis, l’acte d’observation de la « verbalisation » permet une auto-objectivation, menant à l’apport de nouvelles perspectives et d’énergie pour créer la musique suivante.
En moi, la musique peut guider les mots, et les mots peuvent devenir l’engrais qui enrichit le sol de la production musicale. À travers ce cycle, le système continue de produire ses propres composants, à la manière d’une forme de vie autonome.
Et comme le suggère la métaphore de la « forme de vie », il existe un « état de santé » – bon ou mauvais. Plus précisément, dans mon cas, je ressens généralement une sensation malsaine pendant les périodes où je penche trop vers l’activité verbale en tant qu’observateur.
Cette conscience de la sensation est probablement une alerte à la situation où la pratique (la production musicale), qui devrait être l’énergie fondamentale du système, est négligée.
C’est un signal d’alarme indiquant que l’énergie créatrice ne circule pas. C’est un inconfort, comme un gaspillage de ne pas utiliser son potentiel créatif, un signe que la circulation sanguine du système stagne et que sa vitalité s’estompe.
Par-dessus tout, je souhaite être quelqu’un qui affronte la musique et lui donne forme, et je crois que c’est ma façon d’apporter de la valeur. Par conséquent, lorsque je tombe dans une situation où seuls les mots sont épuisés sans la pratique qui les accompagne, je ressens un sentiment de vide. C’est un cliché, mais je suppose que je veux être un praticien avant d’être un critique.
Ce sentiment et ces pensées sont, je crois, un axe crucial de ma propre création. C’est pourquoi, si un grand écart se creuse entre ce qui est produit et les mots qui sont dits, je pourrais ressentir une sorte de frustration ou de dissonance avec moi-même.
En même temps, ce regard est constamment dirigé vers moi-même. La question « Est-ce que le « moi » qui épuise les mots s’éloigne du « moi » qui est praticien ? » agit constamment comme une altérité intérieure (un œil de juge) qui me soutient et m’admoneste à la fois.
Bien sûr, je crois que chacun dans le processus créatif s’arrête, lutte et s’aventure parfois profondément dans la forêt des mots. Ce n’est en aucun cas du temps perdu, et je le ressens ainsi lorsque je réfléchis à mes propres expériences.
Cependant, au-delà de cela, plutôt que de trouver du romantisme à être un « poète qui ne récite pas » ou un « peintre qui ne peint pas », je porte le souhait de me placer du côté de la pratique – de créer quelque chose, aussi petit ou maladroit soit-il.
Ainsi, verbaliser mes pensées de cette manière fait partie intégrante de mon système créatif, et c’est aussi un « mécanisme de bilan de santé » pour cette façon d’être. Et même maintenant, je sens le regard de l’observateur qui me regarde écrire ce texte.
Ce dont j’ai discuté ici est probablement quelque chose que de nombreux créateurs ont ressenti, mais en le verbalisant à ma manière, j’ai le sentiment que ma propre façon d’être est devenue un peu plus claire.
Le temps passé à réfléchir dans l’océan des mots est un terreau important pour ma prochaine création et mon auto-entretien. Mais pour que le cycle créatif ne stagne pas, je crois qu’il est crucial d’avoir une image de remuement continu de l’ensemble, y compris ce processus même de pensée.